Samar Haddad King est de retour à Bordeaux avec sa compagnie Yaa Samar! Dance Theatre, où elle avait présenté Loosing It en 2023. Toujours dans le cadre du Festival international des arts de Bordeaux (FAB), sa nouvelle création, Gathering – du 8 au 11 octobre au TNBA – est une célébration qui défie l’oubli en explorant la mémoire, la fragmentation, l’identité, les effets de la guerre et de l’occupation, la résilience et le sens du collectif.
Chorégraphe, compositrice et artiste palestinienne, Samar Haddad King vit désormais entre New-York et Marseille. Elle évoque à Rue89 Bordeaux son œuvre sur fond de guerre dévastatrice menée depuis deux ans par Israël dans la bande de Gaza.
« Mes choix sont politiques »
Rue89 Bordeaux : Quand et comment Gathering est né ?
Samar Haddad King : L’écriture a commencé en 2018. C’est l’histoire d’une jeune femme d’origine palestinienne qui s’appelle Israa. Elle essaie de recoller les morceaux de sa mémoire. Le texte a été imaginé comme un monologue. À ce moment-là, je faisais aussi des recherches sur les guerres du XXᵉ siècle et sur la manière dont la guerre avait transformé la façon dont les gens se rassemblaient : rassemblements forcés, choisis, ou fortuits. J’étais en résidence à New York, juste avant le Covid.
J’ai réfléchi comment ces moments collectifs pouvaient prendre forme sur scène. Puis, en avril 2023, j’ai construit ce récit autour du personnage central qui est Israa, pour le jour de son mariage.
Vous invitez le public à participer à ce spectacle. Quel est l’objectif ?
C’est avant tout une question de solidarité. Gathering explore la manière dont on s’engage dans la vie : il y a la contemplation et il y a la participation active. Nous avons intégré plusieurs niveaux de participation dans le spectacle. C’est inspiré de chez moi, de la maison où j’ai vécu. J’ai souvent travaillé avec peu de financements ; c’est malheureusement la réalité dans la culture palestinienne. Je voulais donc créer quelque chose qui permette à notre communauté – qui aime participer – de le faire.
Je voulais briser l’idée que l’art contemporain est étranger à notre culture palestinienne. Je ne sais pas si le résultat est « contemporain », c’est simplement ma façon de voir. C’est en tout cas une approche politique et sociale.
Vous avez conçu Gathering de manière à ce que le spectacle puisse « voyager ». C’est une volonté de transmettre votre approche politique au monde ?
Tous mes choix sont politiques. Même si je faisais un spectacle sur les fleurs, ce seraient des fleurs politiques ! Les artistes palestiniens ne peuvent pas y échapper : nous sommes politisés, que nous le voulions ou non. De mon côté, tant que nous ne sommes pas libres, je continuerai à me battre.
Bien sûr, il y a une différence entre propagande et art. L’art doit raconter une histoire, faire voyager, émouvoir. On ne vient pas à mes spectacles pour « apprendre » la Palestine, mais on peut rencontrer quelqu’un, une voix.
Dans Gathering, je raconte l’histoire d’une femme de 25 ans, dont le rêve était de se marier et d’être mère. Et peut-être que cela ouvre un regard, un miroir, une émotion. Mais ce n’est pas une leçon. Je crois simplement que c’est en racontant des histoires qu’on change les perspectives.
« On refuse la mort »
Votre travail parle de résilience et de joie. Quand les images qui nous parviennent de Gaza sont si douloureuses, comment peut-on encore parler de joie ?
Parce qu’elle existe. Et il faut le faire. On ne peut pas être réduits au statut d’opprimés ou de victimes. Cette victimisation nous déshumanise : elle fait de nous des chiffres, des idées. Alors que nous sommes pluriels, avec nos différences, nos désirs, nos besoins.
Et malgré plus de 70 ans de souffrance, malgré l’horreur de ces deux dernières années, nous continuons. La douleur est là, mais la joie et la résilience sont notre carburant. Et ce n’est pas particulier à nous : partout où l’Europe coloniale a laissé des cicatrices, des peuples continuent à vivre, à rire, à résister. C’est ce qui nous maintient debout.
C’est une manière de dire : il y a de la vie. Et tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. Même si je me méfie du mot « espoir », car il a été trop galvaudé, surtout par ceux qui veulent qu’on reste tranquilles, patients. Parlons plutôt de résistance, et de ce que j’appelle la joie politique. Pas comme une négation de la souffrance, mais comme un refus de se laisser détruire par elle. Quand on danse, quand on chante, quand on rit, on refuse la mort.
Vous évoquez souvent la mémoire dans votre travail. Qu’est ce que cette notion veut dire ?
Le théâtre est un espace où chacun peut déposer quelque chose. Quand on répète, on traverse tous nos histoires, nos blessures, nos fantômes. Mais c’est aussi une célébration, une cérémonie collective où l’on pleure et où l’on danse. C’est pour ça que j’ai voulu que les spectateurs participent, parce que le théâtre est, depuis toujours, un lieu de rassemblement, un lieu de solidarité.
Dans les sociétés arabes, ce rassemblement est au cœur de la vie : les funérailles, les mariages, les fêtes, les commémorations. Tout est collectif. Je voulais retrouver cette énergie-là. Quand les spectateurs entrent dans la salle, ils entrent dans un espace de mémoire, de rituels, de récits partagés.
« Créer est ma manière de respirer »
Depuis le 7 octobre 2023, comment les artistes palestiniens, vivant en Palestine ou pas, continuent-ils à créer ?
C’est une question difficile. Parce qu’il y a des jours où je me dis : à quoi bon ? Et d’autres où je sens que c’est nécessaire. Depuis deux ans, on vit dans un deuil continu. Et pourtant, je me dis : si je peux créer un espace où quelqu’un, même une seule personne, se sent moins seule, alors ça vaut la peine. Quand j’étais plus jeune, je pensais que l’art devait changer le monde. Aujourd’hui, je crois qu’il peut simplement aider à des transformations. Et c’est déjà énorme.
En vérité, je ne sais pas comment je continue à travailler. Il y a des jours où je n’y arrive pas, où je regarde l’actualité pendant des heures, sans pouvoir bouger. Et puis je me dis : je n’ai pas le droit de m’arrêter. C’est de la survie. Créer, c’est ma manière de respirer.
Vous parlez souvent de collectif. Quelle est la place des autres dans votre travail ?
Essentielle. Je n’ai jamais voulu être une artiste solitaire. Tout ce que je fais naît de la rencontre. Je viens d’une culture où la création est toujours collective. On écrit ensemble, on répète ensemble, on rit, on pleure ensemble. C’est pour ça que j’ai appelé le projet Gathering – « rassemblement ». Le mot parle de lui-même : il s’agit de rassembler les fragments, les gens, les mémoires, les gestes. Même le public fait partie du collectif.
Dans chaque ville où on joue, le spectacle change, parce que les gens apportent quelque chose de différent. Ce n’est pas un spectacle didactique. Je demande simplement au public d’être présent, d’écouter, de se laisser traverser. Et parfois, quelque chose se passe.
Sur ce spectacle, le public est invité à rencontrer cette femme, Israa, avec ses rêves, ses contradictions, sa colère. C’est ça que je veux, que les gens rencontrent quelqu’un. Pas une cause, pas un drapeau. Une personne. Quand tout est détruit autour de nous, il reste ça : la possibilité d’un geste partagé.
« Une dualité permanente »
Demain nous serons le 7 octobre, dans quel état d’esprit êtes-vous ?
Je pense tout d’abord à deux ans d’horreur. On a vécu avec les massacres de nos proches, nos amis, nos familles. Et en même temps, il faut poursuivre, malgré cette dualité permanente de l’attention que je dois porter à l’actualité d’un côté et mon travail de l’autre. Je me dois cependant de bien faire les choses. Je le dois à mon peuple, aux publics qui viennent, aux artistes avec qui je travaille. Même si l’art paraît si dérisoire quand on parle de vie ou de mort.
Je dis toujours aux artistes avec qui je travaille : au théâtre, il faut mettre sa vie et sa mort dans ce qu’on fait pour embarquer le public dans un voyage. Et aujourd’hui, avec le contexte, ça paraît presque indécent. Mais on ne peut pas s’enliser dans la destruction, même si c’est insoutenable.
Dans le monde, ce n’est pas seulement à Gaza que la souffrance est immense. Elle est partout, dans tant d’endroits touchés par l’impérialisme occidental et le capitalisme. Nous savons que des familles entières sont anéanties en quelques secondes par des guerres. Mais encore une fois, je dois y faire face, absorber et continuer à travailler.
Quelle a été votre réaction quand la France a reconnu l’État de Palestine ?
J’ai été surprise, en fait. Je ne savais même pas qu’ils ne l’avaient pas déjà fait. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose ? Il faut surtout revoir toute la structure mise en place depuis la seconde moitié du XXᵉ siècle. Nous sommes un pays qui dépend complètement de l’argent étranger, des intérêts d’Israël, et maintenant de ceux de l’Arabie saoudite ou du Golfe. Le monde fonctionne comme ça, et il faut revoir tout ça.
Pensez-vous qu’il soit possible de vivre en paix, avec deux États, israélien et palestinien ?
L’impossibilité de vivre ensemble ne vient pas des peuples. Et c’est bien là le point que beaucoup refusent de voir. Si la structure même est inégalitaire, comment cela pourrait-il fonctionner ? Ce n’est pas une question de personnes : Juifs, Libanais, Yéménites, Irakiens, Maghrébins, musulmans… nous avons toujours vécu ensemble. Ça n’a jamais été un problème.
On le sait tous, et beaucoup de Juifs le savent aussi. Il n’y a jamais eu de conflit entre deux peuples. Les Juifs marocains étaient marocains, les Juifs irakiens étaient irakiens. Ce n’étaient pas « deux peuples ». Une religion ne définit pas un peuple. Les Juifs palestiniens étaient palestiniens, comme les musulmans et les chrétiens. Ce ne sont pas deux peuples avec deux États distincts qu’il faudrait « faire s’entendre ». La question est de bâtir un système égalitaire, avec les mêmes droits pour tous.
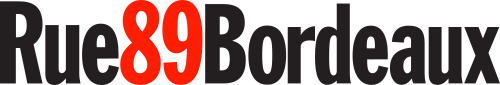

Chargement des commentaires…