« Là, il y a l’Égypte ! Et puis ici, la Jordanie, là, le drapeau de la Palestine, un bout du Vietnam aussi, le Sénégal, le Pérou… Voilà, je fais mon petit tour du monde ! » Sur l’autel du salon de Marcelle Segret, pas de figure divine à l’honneur : seulement des souvenirs de voyages rapportés par ses proches.
Ici, une figurine dromadaire métallique brun noisette, là, une tortue sculptée à la main dans un morceau de bois sombre, à côté, un petit lama enrubanné de tissus aux couleurs vives… Autant de gages de voyages qu’elle chérit :
« Pétra, en Jordanie : c’est mon fils, avioniste [technicien dans l’aéronautique], qui me l’a ramené, celui-ci », s’exclame-t-elle, porte-clé en main.
Pétra, c’est aussi le nom de sa chienne. Treize ans que les deux sont inséparables, et ce n’est pas la cataracte de la bête qui a eu raison de leur amitié. « C’était trop cher les deux yeux, alors je l’ai fait opérer d’un seul », raconte Marcelle Segret. À la moindre visite, la petite boule de poil, aboie, sautille, court… au risque de se prendre les murs, déficit de vision oblige.
Et du passage, il y en a rue des Ayres, près de la place Pey-Berland, où Marcelle Segret vit depuis près de vingt-cinq ans. Des souvenirs, aussi, ravivés au gré de ses lectures et du récit d’une vie qu’elle livre bien volontiers. 81 ans après la libération de Brive-la-Gaillarde, la gamine devenue grand-mère s’en rappelle encore.
À la guerre comme à la guerre
« C’est un peu après la fin que j’ai commencé à fumer » relève-t-elle, en tirant une bouffée sur sa Marlboro. La guerre, elle s’en souvient « comme si c’était hier ». Le conflit éclate alors qu’elle n’a que 11 ans.
Il y a d’abord la mort de son père, Jean-Baptiste, boulanger de métier, mobilisé pendant la campagne de France à Juvisy-sur-Orge, en 1940. « Il avait de l’emphysème aux poumons à cause de la farine, papa a attrapé une pneumonie et il est décédé au tout début de la guerre. »
Marcelle Segret reste avec ses deux sœurs et sa mère, issue de la haute paysannerie du Pizou, en Gironde.
« Elle travaillait très bien de ses mains, elle brodait, elle cousait, elle élevait comme une jeune fille de la bourgeoisie paysanne », raconte-t-elle.
Au début de l’occupation totale du pays en 1942, elle est à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. Elle revoit, la place Thiers, le cours d’Alsace-Lorraine, la caserne, les défilés militaires allemands, les privations, les rutabagas cuits à l’eau sans la moindre épice, le rationnement des « 20 grammes de beurre par semaine et par personne, pis la marchande qui en gardait pour faire son marché noir ». Pêle-mêle, les images s’enchaînent :
« Je portais les sabots. Quelqu’un de la famille, qui, dans des vieux pneus, découpait des demi-semelles pour mettre sous les sabots. Et puis que ça fasse moins de bruit. Ça s’appelait des galoches, pour économiser le bois, parce que si on marchait sans protection, la semelle était vite usée, et ça se cassait. »
Cet article fait partie de l’édition abonnés. | Déjà abonné ? Connectez-vous
Abonnez-vous maintenant pour poursuivre votre lecture
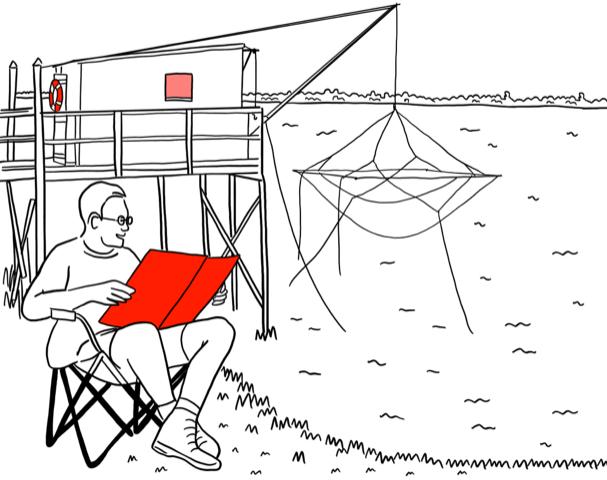
Déjà abonné⋅e ?
Connectez-vous
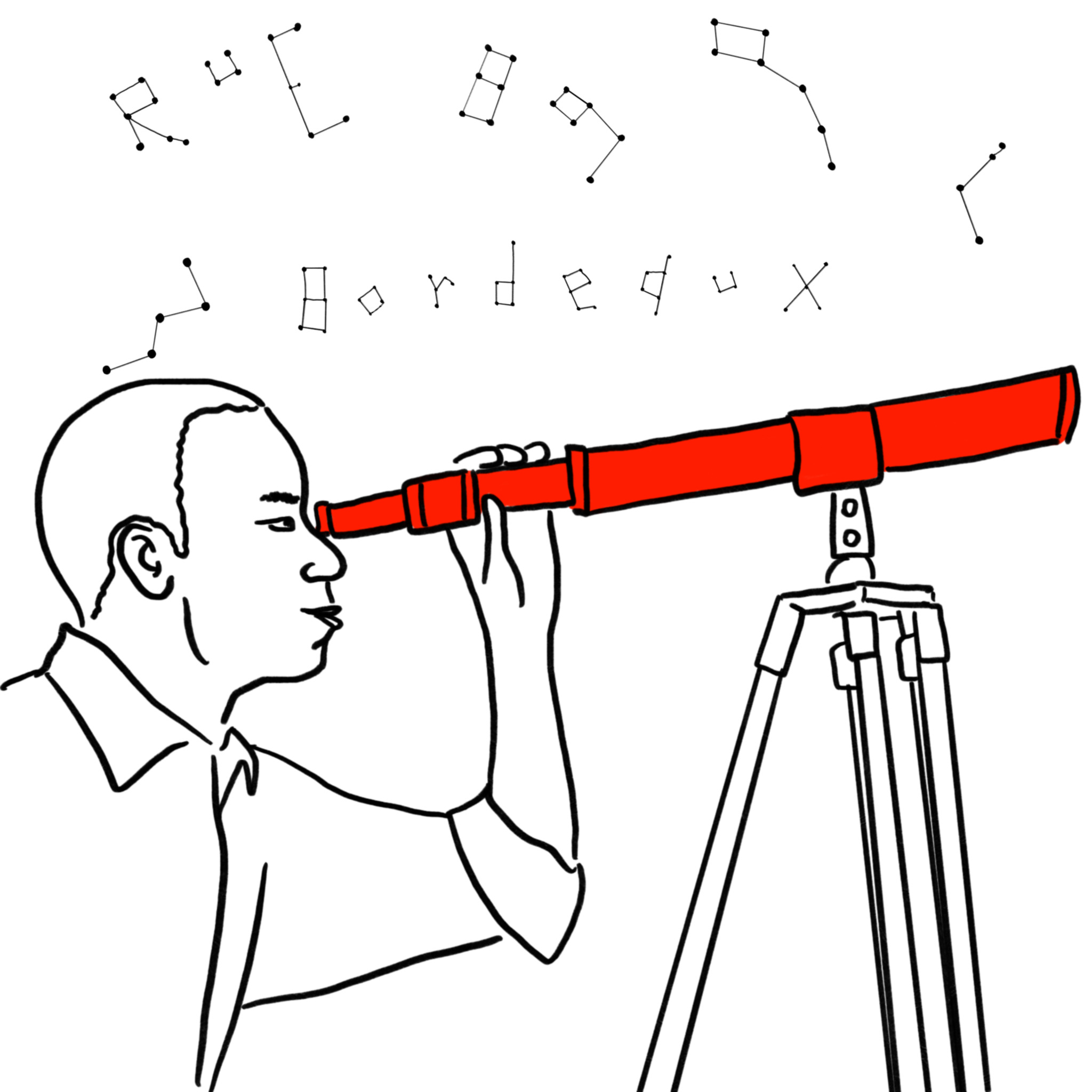
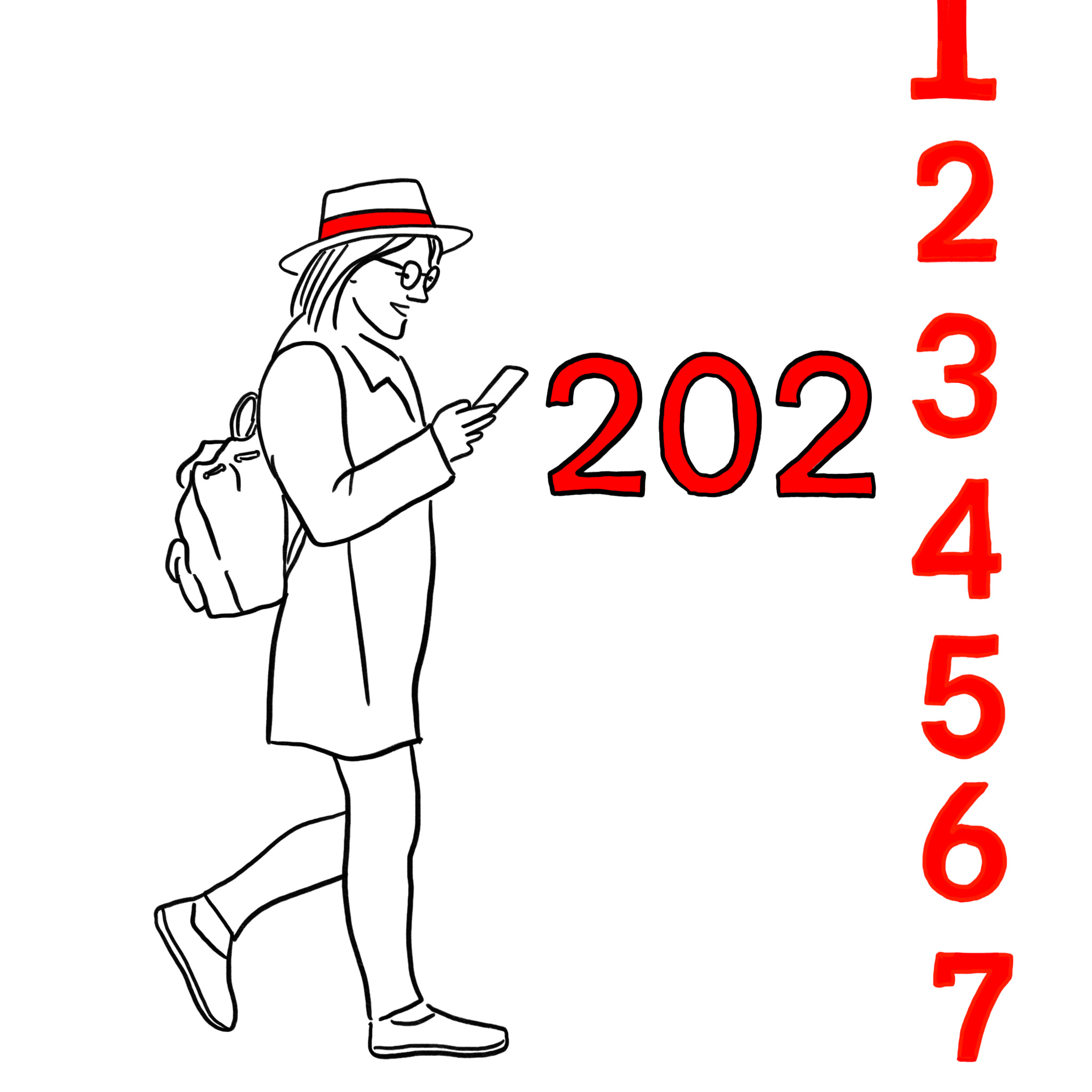
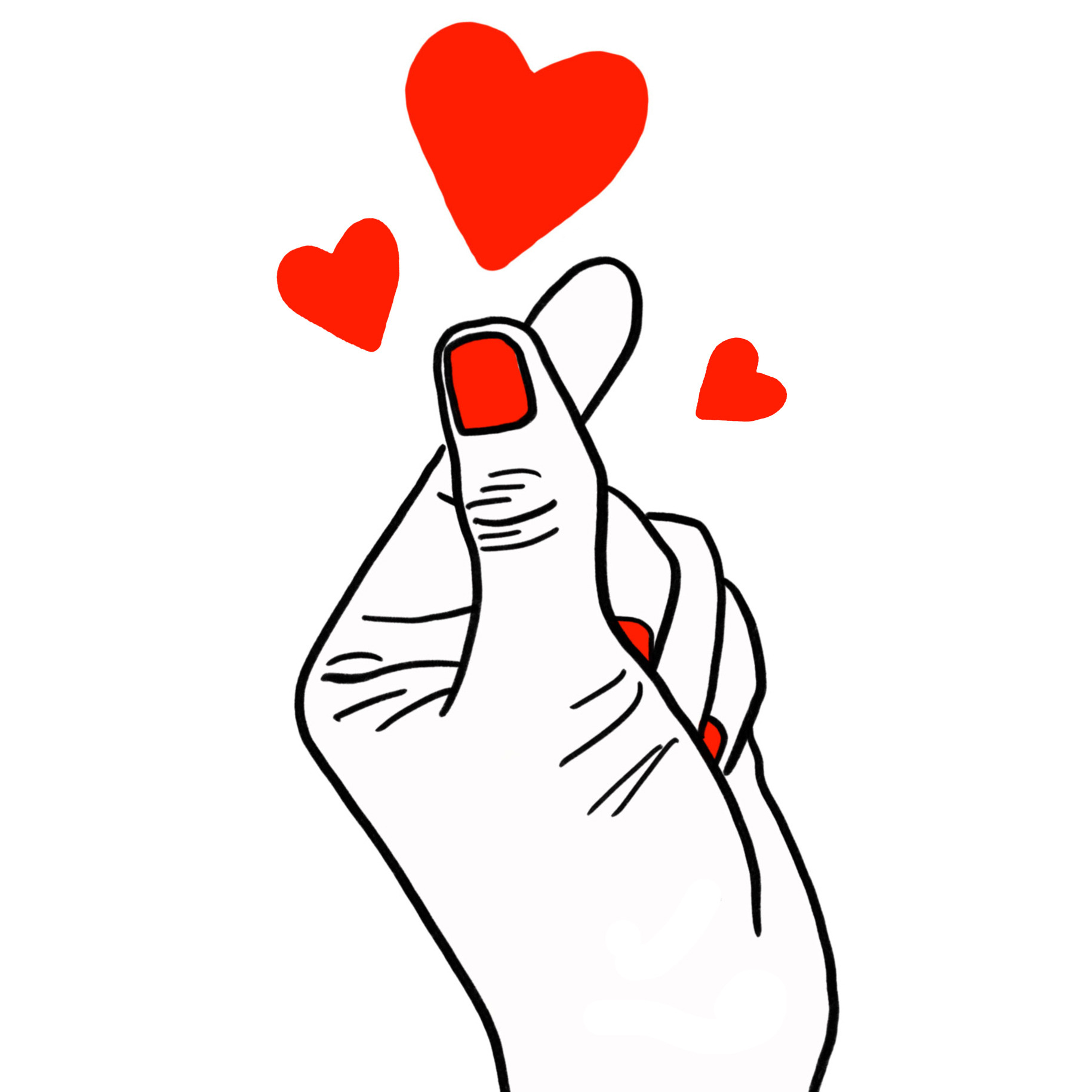




Chargement des commentaires…