Les deux écrivains dont je vais parler ont plus d’un point commun. Le fait que l’un, Alain-Julien Rudefoucauld (à gauche sur la photo © Caroline N. Brun), habite Bordeaux, que l’autre, Philippe Brenot (photo Philippe Lewis), y ait longtemps vécu, est anecdotique ; que l’un et l’autre soient, par leur métier, des connaisseurs des profondeurs du psychisme humain, de ses tours et de ses détours, de l’importance de la sexualité, l’est davantage.
Alain-Julien Rudefoucauld a derrière lui une longue carrière de dramaturge et d’écrivain ; Philippe Brenot se lance, lui, pour la première fois, dans le récit. Ce qui n’est pas sans importance pour la forme même des livres qu’ils ont écrits : il y a chez Alain-Julien Rudefoucauld une puissance verbale, un rapport jouissif à la langue qui lui permettent de jouer sur plusieurs niveaux, du plus classique – ah ! cette phrase d’ouverture, quasi proustienne, qui s’enroule sur une page entière ! – au plus inventif ; chez Philippe Brenot, une retenue, comme une inquiétude à s’aventurer dans un genre dont il s’est jusqu’à présent tenu à l’écart.
Esclave
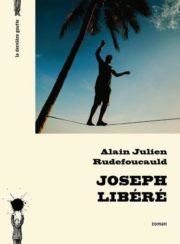 Le personnage du Joseph libéré d’Alain-Julien Rudefoucauld (La Dernière goutte, éd.) est haut en couleur, un métis que la vie n’a pas épargné.
Le personnage du Joseph libéré d’Alain-Julien Rudefoucauld (La Dernière goutte, éd.) est haut en couleur, un métis que la vie n’a pas épargné.
Quelles expériences originaires expliquent les angoisses, les cauchemars qui assaillent chaque nuit ce grand gaillard et le font hurler à réveiller le voisinage ? Le suicide de la mère ? Le spectacle de son corps désarticulé à la morgue où l’on conduit le gamin qu’il est pour qu’il l’identifie ? L’abandon du père ? Oui. Mais aussi, peut-être, la difficulté de rompre avec une passivité que ses ancêtres esclaves lui ont transmise. Il accepte d’être exploité par ses demi-frères métropolitains qui l’obligent à entretenir la maison héritée du père, le bateau, et à vider les lieux quand ils arrivent.
Joseph ne sait pas lire. La rencontre d’un enfant qu’il n’effraie pas et d’une jeune bibliothécaire, Evangéline, le met sur le chemin de la libération. Il a désormais accès au verbe sous toutes ses formes. Il essaiera d’en tirer profit en vendant à un journaliste, un « scribeux », dit-il drôlement, le récit de la mort d’Evangéline dans cet accident dont il est, en partie responsable. Il faudra du temps, des épreuves, des drames pour qu’il parvienne enfin, en un grand feu de joie, à brûler la cabane où il est relégué quand ses frères sont là et à s’arracher à ses chaînes.
Parano
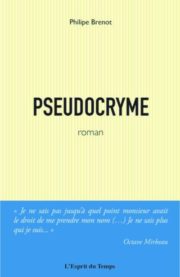 Pseudocryme, le récit de Philippe Brenot (L’Esprit du temps), est une variation virtuose sur le thème du double. Deux personnages dont l’un est le thérapeute, l’autre est le patient paranoïaque convaincu que le premier lui a a volé son nom et le livre qu’il écrivait, se suivent, se poursuivent, se retrouvent sans qu’on sache toujours qui est qui.
Pseudocryme, le récit de Philippe Brenot (L’Esprit du temps), est une variation virtuose sur le thème du double. Deux personnages dont l’un est le thérapeute, l’autre est le patient paranoïaque convaincu que le premier lui a a volé son nom et le livre qu’il écrivait, se suivent, se poursuivent, se retrouvent sans qu’on sache toujours qui est qui.
Brennot se livre à un jeu sur les patronymes qui peut donner le vertige puisque le nom de son personnage est un anagramme du sien propre : Brenot/Breton (André, bien sûr)/Berton, Trébon – et surtout Brontë, prénommé Philip, écrivain oublié auquel ses sœurs ont damé le pion et qui est mort fou – était-il le seul vraiment génial de la fratrie ?
« Aussi loin que je me rappelle, j’ai cherché à prendre un faux nom, un alias, une double identité […] Toute mon enfance j’ai inversé ses syllabes [celles de son véritable patronyme, celle du nom du père (PR) ], mélangé les lettres, j’ai tenté l’anagramme, essayé l’acrostiche, joué sur l’accentuation. « (p.52/3)
A ce jeu qui met en péril l’identité, quel est le perdant, quel est le gagnant ? Le thérapeute ou le malade ? On ne sort pas impunément du vertige du dédoublement, jusqu’où est-on capable d’aller pour ne pas jouer les doublures ?
L’écriture de Brenot est d’une élégante précision – ce qui est souvent le cas dans la paranoïa ; en revanche, le thérapeute est moins fascinant que son malade – ce qui est le jugement habituel des non-spécialistes, parmi lesquels je me range !






Chargement des commentaires…