Dans la salle d’attente de Médecins du Monde rue Charlevoix-de-Villiers à Bacalan, le téléphone ne cesse de sonner pendant les trois heures de consultations. Ici, tous les jours de 9h à midi, on accueille les personnes dans des situations précaires rencontrant des difficultés pour se soigner. Aude Saldana-Cazenave, la coordinatrice régionale, confirme la première impression :
« 80 % des personnes venant ici sont des migrants, mais nous faisons un accueil inconditionnel. On les reçoit d’abord ici, au Caso, le centre d’accueil de soins et d’orientation pour savoir quels sont ses obstacles à l’accès aux soins. »
Ils peuvent être reçus par un médecin, un gynécologue, un psychologue, faire un dépistage du cancer du côlon, mais aussi obtenir un accompagnement social. Les états de santé sont de plus en plus complexes selon Médecins du Monde Bordeaux. Le jour ne notre visite, il n’y pas de dentiste, pour le plus grand malheur de ce jeune homme à l’accueil, dont le visage exprime à la fois douleur, déception et colère. Vu l’urgence, il est orienté vers la Pass de Saint-André. « La Pass ?! »
Manque de soins
Ce n’est en effet pas vraiment évident de comprendre le système de santé et tous ses acronymes « qui peuvent changer d’une année sur l’autre » souligne Aude Saldana-Cazenave.
Ce jeune homme doit se rendre à la permanence d’accès aux soins (Pass) à l’hôpital Saint-André à Bordeaux, la plus vieille de la ville ouverte il y a plus de 20 ans. L’organisme public permet « aux personnes en situation précaire de leur assurer une prise en charge de qualité ». Français ou non. Il en existe 5 dans la métropole bordelaise, 12 dans le département de la Gironde, 21 dans la région.
La plupart des Pass sont installées au sein même d’hôpitaux publics des grandes villes françaises et régionales. On en trouve également dans des cliniques.
Selon l’observatoire de l’accès au droit et aux soins de Médecins du Monde de 2016, Bordeaux se place en quatrième position quand au nombre des consultations médicales dans les Caso, avec 3271 consultations après les 6508 de Saint-Denis, 3388 à Paris et les 3337 à Marseille. Les personnes les plus démunies peuvent consulter des médecins généralistes, des spécialistes, pour des consultations dentaires quand la structure le propose, des consultations para-médicale ou des psychologue. Mais c’est là que le bas blesse selon Aude Saldana Cazenave, que ce soit dans les Caso ou dans les Pass :
« On note une augmentation des Pass spécialisées mais on a toujours un grand déficit d’accès à la santé mentale. L’instabilité administrative (stress d’être arrêté, peur d’être reconduit à la frontière), la précarité (non ou mal logement, angoisse de ne pas savoir où dormir, peur de l’agression, manque de sommeil et de nourriture), l’isolement et la déception (confrontation de leurs espoirs de migration avec la réalité) entretiennent et renforcent le mal être psychologique de nos usagers. »
Sigles médicaux
CASO : Centre d’Accès aux Soins et d’Orientation
AME : Aide Médicale d’État
CMU-C : Couverture Maladie Universelle Complémentaire
PUMA : Protection Universelle Maladie
CMS : Centre Médicaux Social
CMP : Centre Médicaux-Psychologique
CMPI : Centre Médicaux-Psychologique Infantile
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie
L’acronyme qui rend fou
Une fois passé par la Pass, le jeune homme devra très certainement apprendre d’autres acronymes liés à la santé. PUMA (protection universelle maladie, cf. encadré), CMU, CMU-C, AME… Peut-être aura-t-il besoin de se rendre dans un CMS, CMP ou un CMPI s’il a un enfant. Et s’il réussit à être régularisé, il lui faudra connaître la CPAM, la CAF et bien d’autres sigles administratifs. Il devra être connecté pour envoyer des documents dématérialisés à envoyer sur des plateformes ou bien par mail.

Thomas (tous les prénoms des migrants ont été modifiés) a réussi à avoir une couverture médicale et sociale, il y a quelques mois. Ce jeune Camerounais de 23 ans est en France « depuis longtemps ». Son corps est marqué par les stigmates des opérations subi depuis son arrivée en France. À chaque fois que ce grand gaillard de près de 2 mètres vient à Médecins du Monde, il va directement dire bonjour à « Mamie », Michèle à l’accueil. Il vient lui ramener les médicaments dont il n’a plus besoin et lui signifier que son traitement contre la thyroïde est terminé. Aujourd’hui il est même venu avec un jeune migrant rencontré dans le tramway.
« J’ai tout eu comme maladie du corps, de l’esprit, de la tête, du ventre… Tout. » Il n’ira pas plus loin dans l’explication. Sa cicatrice à la base du cou et celle sur les mains permettent d’imaginer l’ampleur des opérations. « Du coup, je repère facilement les gens en galère et je peux les aider. »
Direction le droit commun
Pour les demandeurs d’asile comme Thomas ou les réfugiés, il existe une couverture médicale spéciale : la PUMa, la protection universelle maladie. Elle couvre toutes personnes résidant ou travaillant en France de manière régulière. Elle peut être complétée par la CMU-C, la couverture maladie universelle complémentaire (elle peut s’additionner à la CMU), pour toute personne à faibles ressources. Cela permet aux réfugiés d’entrer dans le régime général obligatoire et d’accéder au parcours de soin classique, en choisissant un médecin traitant à déclarer à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
Pour ceux qui n’ont pas encore de situation régulière, il existe l’aide médicale d’État (AME). C’est ce qu’est venu demander Hamed. Ce Comorien de 43 ans est en France depuis 20 ans.
Il tient fermement une pochette bleue dans ses mains. À l’intérieur : les preuves de sa présence en France depuis au moins trois mois, ses conditions de ressources et d’autres papiers importants… Il est enregistré depuis peu à la préfecture de la Gironde et peut avoir accès à la sécurité sociale. En revanche, il doit encore attendre quelques mois la réponse définitive de l’Ofpra (Office français de protection de réfugiés et apatrides) avant de pouvoir travailler.

« J’ai fait des formations d’employé de libre-service ou de mécanicien. À Bordeaux, j’ai surtout travaillé dans un restaurant coté. Un jour, un de mes collègues a dit à mon patron que mes papiers étaient des faux. Je me suis fait virer. Aujourd’hui, j’ai fait une demande d’asile en cours d’instruction. Regardez, sur le récépissé, il y a marqué que je ne peux pas encore travailler. Mais il faut que je mange, que je m’habille et que j’aide mes enfants. Donc je continue de travailler au noir. »
Hamed a vite appris le français pour pouvoir s’exprimer et travailler. « C’est important de faire quelque chose. » Par son parcours entre Marseille, la Bretagne ou Bordeaux, il connaît parfaitement les rouages de la fuite, de l’esquive des contrôles policiers et comment passer inaperçu…
« Là ça va un peu mieux. Je vis plus sereinement. Si la réponse est négative, je vais devoir me cacher comme avant. »
L’autre souci, c’est le logement. Pour ceux qui comme Thomas vivent « à droite à gauche », la domiciliation peut être faite dans un CADA (Centres d’accueil des demandeurs d’asile). Une adresse provisoire le temps d’avoir une réponse de la préfecture et de l’Ofpra.
Pour d’autres, il leur est même difficile de fournir une pièce d’identité perdue pendant l’exil.
« – Si jamais vous vous cassez une jambe ou que vous avez besoin de médicaments, vous n’êtes pas couvert. Vous ne pourrez pas vous faire soigner.
– D’accord.
– Avez-vous vos papiers ?
– Non, tout est resté à Toulouse et je ne peux pas aller les chercher.
– Il nous faut un document avec votre nom.
– Je n’ai rien sur moi.
– Et votre ambassade ?
– Pas possible…
– Ok, on va voir ce qu’on peut faire. »
« La santé, ce n’est pas une lubie ou un luxe ! »
« Je ne compte plus le nombre de fois où j’ai dû faire des pieds et des mains pour qu’un médecin prennent en charge un migrant avec une CMU-C, souligne Céline Potin, infirmière en CADA et centre d’accueil d’urgence (CAU). Certains ont des réticences, et c’est d’ailleurs difficile de les avoir directement en ligne pour les sensibiliser ou les inciter à prendre des migrants en consultation. Parfois on nous dit simplement qu’il n’y a pas de place pour de nouveaux patients. Je fais même des courriers expliquant le suivi du patient. Généralement, on revient toujours vers les mêmes médecins. Et puis, les migrants parlent entre eux et savent vers qui se diriger pour être pris en charge de manière correcte. »
Dans le milieu médical aidant les migrants, on ne présente plus le docteur Gilla Taveaux-Nemayechi. Son cabinet est un lieu de rencontre, un endroit où l’on ne se retrouve pas catalogué. D’ailleurs, elle tient à une clientèle de toutes origines, de toutes situations : migrants ou non.
« C’est de l’ordre de la déontologie. Je veux bien comprendre qu’il y ait trop de monde dans les cabinets, que la barrière de la langue et la barrière culturelle soient des freins pour des médecins, mais on y arrive. »
Le cabinet du docteur Gilla Taveaux-Nemayechi est situé en plein cœur du quartier Saint-Michel. Comme chez médecins du Monde, à la Pass, ou dans d’autres associations d’aide médicale aux migrants et aux plus démunis, elle affirme « prendre les patients en charge dans leur globalité » – aux niveaux psychologique, social, de l’hébergement…
« La santé ce n’est pas une lubie ou un luxe, ajoute Céline Potin. Les migrants subissent une vraie violence de toute part. Et tout ça dans une langue pas toujours bien comprise. Quand il s’agit de santé, il faut ajouter le jargon déjà compliqué pour nous Français. »
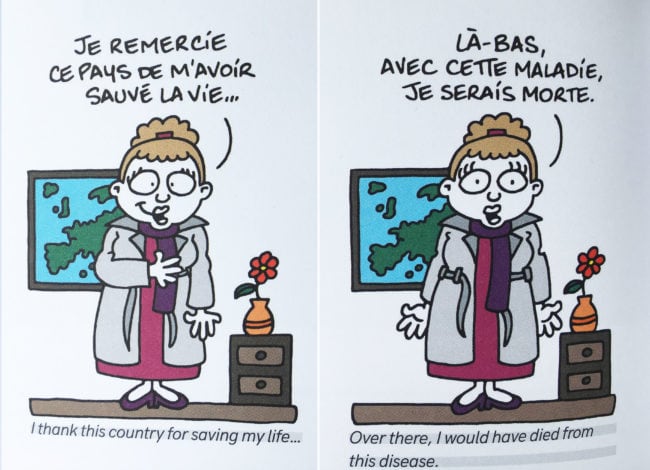
Langue maternelle et langue de bois
Une des plus grosses difficultés est en effet de comprendre et de se faire comprendre. D’ailleurs les bénévoles à l’accueil ont tous des notions d’anglais et d’espagnol.
« Certaines personnes sont passées par des pays anglophones ou hispanophones. Cela nous permet de pouvoir échanger », confirme Hélène, à l’accueil ce jour-là.
Pour les autres langues, c’est plus compliqué. Elle est souvent tentée d’appeler l’un des numéros d’interprètes accrochés au mur près du téléphone.
« Le problème, c’est qu’ils sont chers. Alors on demande aux bénévoles sachant parler une langue proche de celle du patient de nous aider. Dès qu’elles le peuvent, les personnes viennent avec un membre de leur famille ou des amis pour la traduction. »
Gilla Taveaux-Nemayechi parle plusieurs langues dont l’Afghan et l’Iranien. Elle a commencé sa carrière dans l’humanitaire en Afrique et en Afghanistan notamment. Elle a également travaillé avec des migrantes au sein d’Ippo, association qui vient notamment en aide aux personnes en situation de prostitution. Elle suit certains patients depuis 15 ans.
« Quand on est dans leurs pays, nous avons une compréhension directe de la situation géopolitique et des notions culturelles de base sur les représentations médicales. Que ce soit sur la grossesse, les enfants, la sexualité, les mots utilisés pour désigner les maux sont plus facilement interprétable. »
Ce qui complique les prises de rendez-vous.
« Certains patients ne vont pas au rendez-vous, déplore Céline Potin. Quand on creuse, on prend la mesure des grosses difficultés personnelles. »
Cercle vicieux
Et parfois il y a des loupés.
« Une personne a attendu 2 mois pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste à l’hôpital, raconte Céline Potin. L’interprète n’était pas prévenu et il a fallu reprendre encore un rendez-vous. Le patient n’a pas compris pourquoi et est resté avec son mal-être, ses complications de santé, sa souffrance et les professionnels étaient excédés. C’est un cercle vicieux. »
Conséquence : il a fallut reporter le rendez-vous. Cette fois Céline Potin a pu en avoir un autre rapidement. D’autres fois, les patients peuvent attendre encore quelques semaines avant d’avoir un nouveau rendez-vous médical.
Pour toute ces raisons, parfois, Gilla Taveaux-Nemayechi outrepasse ses devoirs
« Mon premier souci est de soigner les patients. Si je peux les orienter, je le fais. Si je dois me déplacer, je le fais. Il y a une réelle confiance. Je détecte deux difficultés en plus des problèmes de santé : la trajectoire et les stress traumatiques qui en résultent. Certaines personnes peuvent donner l’impression d’instrumentaliser le système. Parce qu’on leur demande de raconter des choses. Ils ne sont pas dans la théâtralisation de leur vie. Un silence est parfois plus lourd que des mots. »
Le genre de comportement apprécié par Hamed, le Comorien.
« Partout où je passe, je vais toujours chez Médecins du Monde. Je préfère venir ici, au moins, on sait qui je suis. On m’explique ce que j’ai à faire. Des assistants sociaux, des juristes peuvent aussi nous aider. En ville, il paraît que ce n’est pas toujours facile de se faire soigner. »

Des solutions ?
Il en existe des très concrètes : toutes celles déjà mises en place par l’état et les délégations aux associations de services publiques en termes de soins, de logements, de suivis de dossiers, d’emploi, d’apprentissage du français, de finances, de mobilité, en termes de formations des bénévoles… Seulement, tout ressemble à un millefeuille délégué gracieusement aux associations par l’État.
« On en vient à s’occuper de personnes hors du circuit de soins, déclare Alban Daméry, assistant social à Médecins du Monde Bordeaux. Elles devraient les avoir soit par l’État soit par le conseil départemental. C’est questionnant. On en est à orienter des familles vers des squats car elles sont en véritable danger pour leur santé. Comment suivre un traitement en trithérapie tous les jours quand on est à la rue ? On peut faire des actions juridiques bien sûr. Mais ce qu’on ne veut surtout pas faire, c’est créer une filière pour les pauvres. C’est bien de répondre dans l’urgence, mais il faut dénoncer ces situations. »
Les formations obligatoires des professionnels de santé dès l’école manquent tout autant.
« Il existe bien des formations et des spécialisations, précise Céline Potin. Ils intéressent surtout les convaincus. Le plus dur est de faire venir ceux qui ne s’y intéressent pas par méconnaissance. Ce travail de réseau est déjà en place. Les structures travaillent conjointement avec plusieurs disciplines : médecins généraliste et spécialistes, infirmiers, assistant et animateurs sociaux, juristes, psychologues, pédiatres… C’est loin d’être généralisé. »
De plus, des outils sont déjà mis en place comme le suivi des soins médicaux via une plateforme accessible à tous les professionnels intégrant le parcours de soin des patients migrants. Cela permet, entre autres, d’éviter les pertes de documents. D’autres idées comme celles-ci sont développées mais peinent à exister.





Chargement des commentaires…