Dossier #29 : Bordeaux mélange des genres
Jessica et Léo, deux Bordelais en transition
Agressions et discriminations LGBTphobes : que fait la police ?
Il ou elle ? Ce que Bordeaux fait pour conjuguer les genres
A Bordeaux, les avis divergent sur la prise en charge des personnes trans par la Sofect
A l’instar de huit autres villes de France, la Société Française d’Etudes et de prise en Charge de la Transidentité (Sofect) a ouvert au CHU de Bordeaux en juillet 2010. Son objectif est de « réunir les professionnels de la prise en charge en France des problèmes relatifs à l’identité de genre ».
La création de la Sofect a fédéré des réseaux régionaux dont certains existaient déjà depuis les années 1970. A Bordeaux, il s’agit du programme Transgender.
Dès la création de l’association proposée par la Haute Autorité de Santé, des voix se sont élevées comme l’écrit un rapport datant d’avril 2011 de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) :
« La création de la Sofect est alors apparue, pour les associations comme pour les représentants de l’Etat, comme une tentative de préempter le débat, de s’octroyer le monopole de la prise en charge des trans et en définitive, de tuer dans l’œuf l’ouverture recherchée au départ. »
Depuis, l’image de l’association ne semble pas s’arranger. Arnaud Alessandrin, docteur en sociologie de l’université de Bordeaux, critique ouvertement sa « position hégémonique ».
Le rôle de la psychiatrie
Les critiques d’Arnaud Alessandrin ne manquent pas. Le chercheur réclame « le libre choix du praticien », le « respect des préconisations internationales notamment sur les hormonothérapies concernant les mineurs et sur les dosages hormonaux ». Mais dans sa ligne de mire, le recours à la psychiatrie :
« Le rôle de la psychiatrie dans ce protocole de santé est majeur et les personnes trans sont psychiatrisés dans le sens où elles sont suivies durement et longuement par des équipes psychiatriques. Il s’agit complètement d’une pathologisation, d’une stigmatisation des personnes transidentitaires. Quand on regarde les quelques chiffres dont nous disposons, je pense notamment à l’enquête de l’Inserm en 2012-2013, on observe que l’immense majorité des personnes trans se font opérées à l’étranger parce que l’accès aux opérations en France reste très compliqué et conditionné par les avis psychiatriques. »
Arnaud Alessandrin propose de « ne pas conditionner les opérations de reconstitutions mammaire, ou vaginale, ou pénienne, ou des chirurgies plastiques à autant de suivi psychiatrique lié à des protocoles aussi strictes… comme ce qui se fait déjà dans de nombreux pays étrangers ».
« La crainte de ses protocoles est que les personnes trans regrettent et veulent revenir en arrière. Or statistiquement, on est à moins d’1% de personnes trans qui regrettent leur opération. Et quand on leur demande ce qu’elles regrettent : elles regrettent moins les opérations génitales que les conditions de leurs opérations génitales. Par exemple comment se fait-il qu’en France on ne propose pas systématiquement aux personnes trans désireuses d’une vaginoplastie de garder leurs gamètes ? […] Comment ça se fait que ce protocole stérilise des personnes ? »

Mégenrage
Sur la page dédiée à Bordeaux du site internet de la Sofect, la liste des associations partenaires n’est pas longue. Voire pas du tout. Il n’y en a qu’une : Trans 3.0. Son président, Azur Roques (lui-même suivi par la Sofect), rapporte que l’équipe bordelaise « fait des efforts pour venir vers les assos » et il dit avoir eu à faire avec « des personnes dans l’optique d’améliorer leur service et leur communication ».
L’entretien accordé et ensuite annulé par la Sofect
Comme nous l’avons annoncé dans la présentation de ce dossier, un entretien était prévu avec Domitille Plarier, responsable de l’antenne bordelaise de la Sofect. La veille du rendez-vous et après lui avoir transmis le plan de notre entretien, nous avons reçu cette réponse :
« J’ai pris connaissance de vos questions ce matin, et en ai discuté avec plusieurs médecins de l’équipe. En accord avec leurs avis, je ne souhaite pas que cette interview soit réalisée. »
Nous avons cependant maintenu ce sujet et avons pu le développer avec des témoignages et des avis de spécialistes.
Rue89 Bordeaux a contacté l’antenne bordelaise pour en savoir plus, sans succès (voir encadré). Certaines personnes trans bordelaises évoquent un service « opaque », des « messages restés sans réponses : ils ne rappellent jamais ». Marie Erramouspe, présidente du Girofard, ajoute :
« Les avis sont mitigés. Des personnes sont ravies d’êtres passées par là, même si ça n’a pas été facile, d’autres ont vécus ça comme une contrainte. Elles viennent chez nous pour trouver un espace où décharger la pression qu’elles subissent. »
« Ils testent les personnes trans, surenchérit Azur Roques. Subir le mégenrage par exemple [le fait d’appeler une personne par son sexe assigné au lieu de celui auquel elle s’identifie, NDLR], peut être dangereux. Même si on est sûr de soi, on peut avoir du mal à s’affirmer. »
Le mégenrage, Jeanne Swidzinski connaît bien. En 2010, elle est en relation avec un psychiatre de la Sofect Bordeaux :
« Je me présente Jeanne. Il me dit : “Ah bon vous avez changé votre identité ?” Je lui ai dit que la demande est faite. Il a exigé mon prénom masculin. Ensuite, ma profession : éducatrice sportive. Il corrige éducateur sportif. […] Partout, j’étais noté “patient” au masculin, “transsexuel” au masculin. Il s’est borné à la terminologie médicale et au genre assigné à la naissance ; le numéro 1 ou 2 du numéro de sécu. Il ne m’a pas reconnue comme je suis. C’est humiliant. »
« Mettre en danger »
Décidée, Jeanne Swidzinski prouve à chaque occasion sa détermination : elle consulte des psychiatres en dehors de la Sofect pour faire accélérer sa transition, elle obtient les prescriptions pour des analyses de sang par d’autres biais, elle effectue des tests de son côté. « Il faut montrer qu’on est décidé », admettant que faire attendre est « une mise en danger ».
Aujourd’hui vice-présidente de Trans 3.0 après en avoir été la présidente, elle ajoute :
« A la Sofect, ils évaluent l’expression du genre. C’est-à-dire, est-ce que la personne, une fois sa transition terminée, va-t-elle devenir invisible aux yeux de tout le monde ? Pour eux, Il est difficile de faire une transition si on n’a pas une apparence conforme, si la transition n’est pas binaire. Il faut une transition nette du masculin vers le féminin ou du féminin vers le masculin. Ils n’aiment pas tellement les indéfinis. […] Du coup, il y en a qui sont mis en attente et, quelque part, ces personnes sont en danger. Car une fois qu’on a pris conscience de notre transidentité, si on ne fait pas quelque chose pour avancer, il y a des risques : tentatives de suicides, automutilations, scarifications… »
« On est donc face à des protocoles de soins qui éloignent des soins », ironise Arnaud Alessandrin.
« Les personnes trans établissent des soins dans un marché parallèle. Elles vont sur internet, et elles essaient de créer des marchés de réputations, en matière de bon ou de mauvais traitements, évalués en retour sur les réseaux sociaux. […] Il existe aujourd’hui dans différentes régions de France des médecins qui sont formés à ces questions, sensibles aux questions LGBT, qui commencent à proposer des offres de soins qui ne sont pas psychiatrisantes ou moins psychiatrisantes. Mais pour les chirurgies, il faut aller ailleurs. Nous n’avons pas encore des chirurgiens en France qui acceptent d’opérer sans avis psychiatrique. Les opérations peuvent se faire à l’étranger, mais elles ne seront pas remboursées. »
ALD
C’est sur ce point que le jeune Louca relève un paradoxe. Agé aujourd’hui de 20 ans et suivi par la Sofect depuis ses 18 ans pour sa transition, il relativise les critiques sur la pathologisation du procédé :
« C’est la réalité ! Nous sont atteint d’une pathologie qui est que nous ne sommes pas dans le bon corps. Si c’est pas une pathologie, ce ne serait pas une ALD (Affection Longue Durée qui concerne les maladies nécessitant un suivi médical avec des soins santé prolongés et une prise en charge à 100%, NDLR) et on n’aurait pas accès aux soins remboursés : la testostérone que tout le monde ne peut pas se payer, les rendez-vous chez les psy… Ça ne me pose pas de problème de dire que je suis atteint d’une pathologie. Certes elle n’est pas mortelle mais c’est quelque chose de lourd. C’est vrai que le mot pathologie est fort, mais on est entouré de mots forts et violents dans notre transidentité. »
De son côté, Sarah justifie la psychiatrisation. Ayant débuté la transition à l’âge de 52 ans, elle loue l’accompagnement psychiatrique et reproche « comme seul bémol » à la Sofect à Bordeaux ne pas le proposer après l’opération de réassignation.
Celle qui se considère comme « un des rares cas à avoir été pris en charge aussi rapidement », regrette presque cette rapidité : premier rendez-vous en juillet 2016, hormonothérapie en novembre 2016, opération en juillet 2017. Et depuis, un suivi régulier auprès de son chirurgien.
« 15 jours avant l’intervention, ma psychiatre me dit “c’est la dernière fois que je vous vois”. J’ai senti un vide ! Pour moi, c’est là que tout commence, avec l’intervention. C’a été le plus beau jour de ma vie, mais là, on ne revient plus en arrière. Après 50 ans, on déconstruit beaucoup de choses : je divorce, je change de ville… C’est un parcours difficile et on vit avec encore tous les jours. Vous avez un passé que vous ne pouvez pas effacer et que vous ne pouvez pas révéler. Il y a des choses dont j’ai envie de parler, et si j’en parle je vais me dévoiler. Je n’ai pas envie de me dévoiler. Il y a des choses du passé dont vous ne parlez plus jamais à personne. »
Fpath : comme fin du blocage ?
Un étude publiée sur le site des archives ouvertes des Sciences de l’Homme et de la Société rattaché au CNRS a pour objet les « Controverses des prises en charge des situations trans : une ethnographie des conférences médico-scientifiques ».
Datant de juillet 2019, elle compare les conférences médico-scientifiques de la Sofect « qui regroupe uniquement des professionnels de santé », à celles de la Wpath (Word Professionnal Association for Transgender Health), une association internationale « qui réunit, dans un partenariat institué, des professionnels de la santé et des militants trans ».
Les conclusions de l’étude font apparaître deux manières différentes de fonctionnement entre les deux structures, « allant du partenariat institué de façon interne dans le cas de la Wpath, à une opposition ouverte dans le cas de la Sofect, qui reste fondée sur la négation des compétences de l’autre camp ».
« Plus de six ans après la publication du rapport de l’IGAS et de l’article de Bujon et Dourlens (2012), qui faisaient le constat des difficultés de communication entre les différents protagonistes du dispositif trans en France, celui-ci semble toujours marqué par une situation de blocage. Cette situation ne se retrouve pas dans les autres pays que nous observons (Brésil, Italie, Norvège) où les collaborations entre les professionnels de santé et les représentants des associations trans se développent depuis de nombreuses années », souligne l’étude.
A noter que, depuis octobre 2019, la Sofect a changé de nom pour devenir Fpath. Ce nouveau sigle s’inspire incontestablement de celui de Wpath, considérant que le F est pour France en remplacement du W pour Word (monde). Peut-être un signe d’une nouvelle transition.
Cet article fait partie de l’édition abonnés. | Déjà abonné ? Connectez-vous
Abonnez-vous maintenant pour poursuivre votre lecture
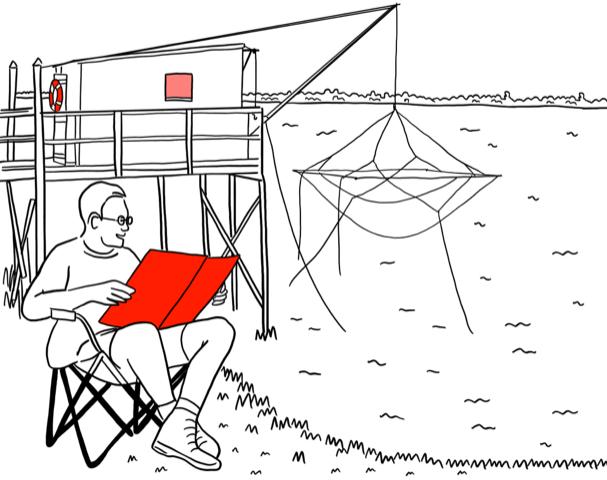
Déjà abonné⋅e ?
Connectez-vous
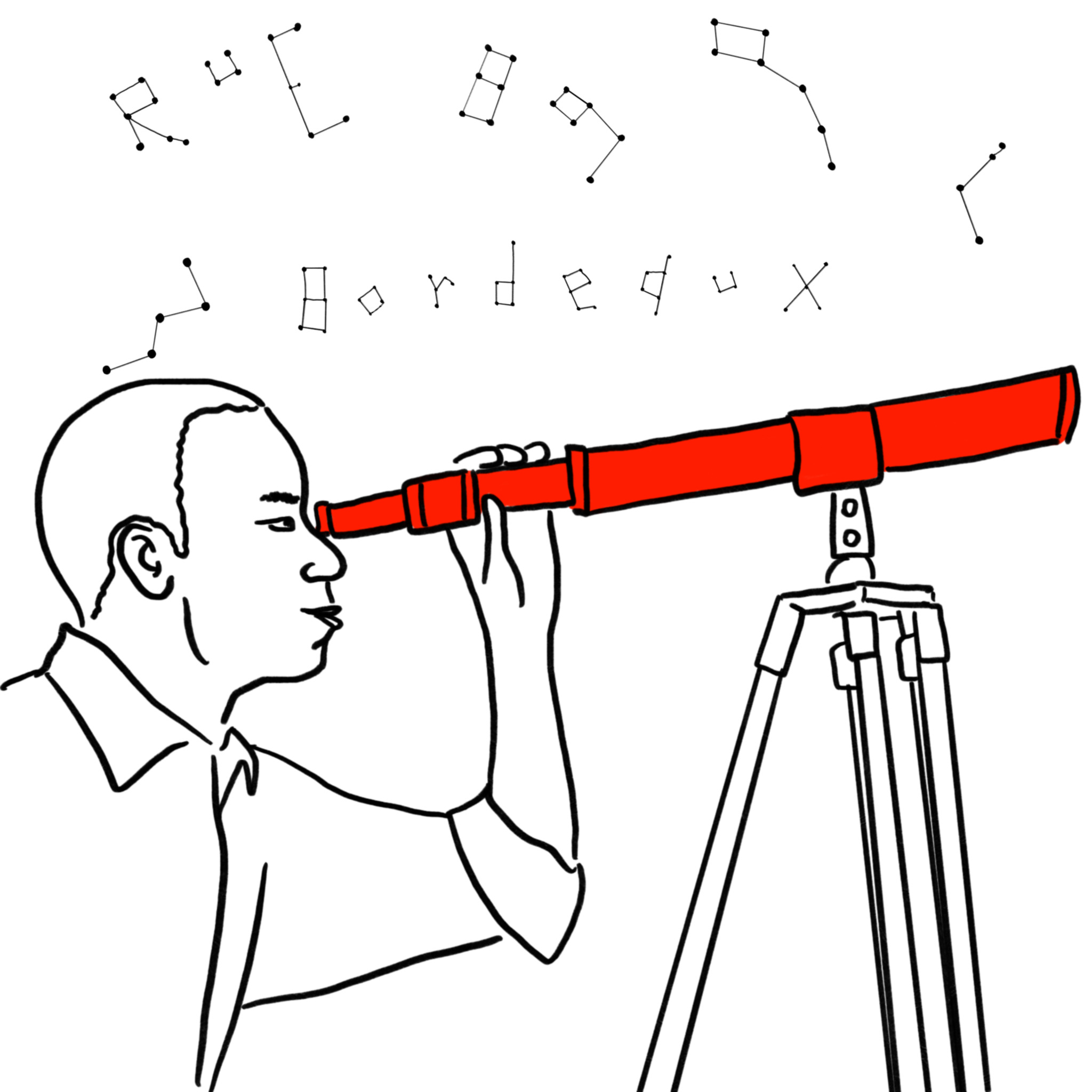
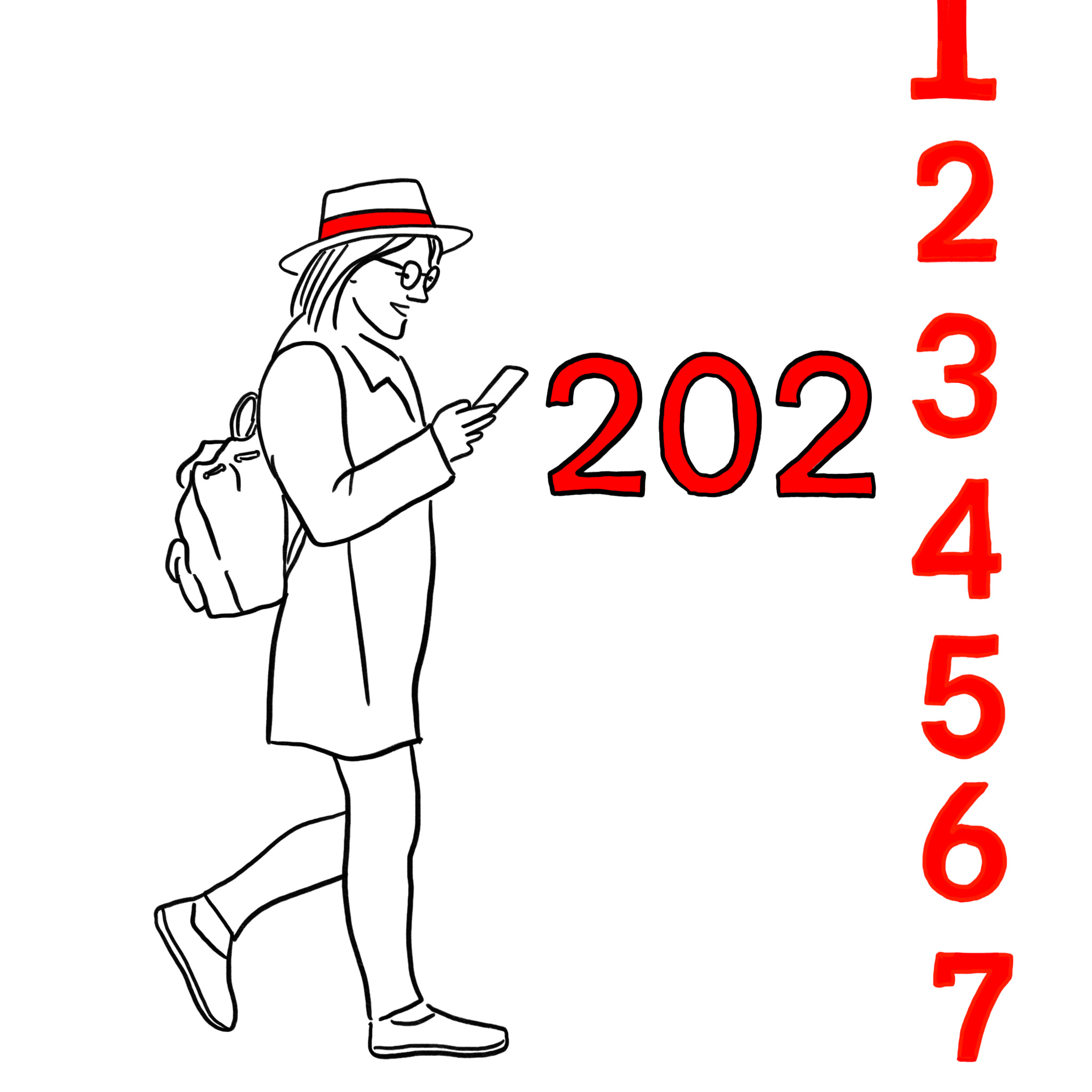
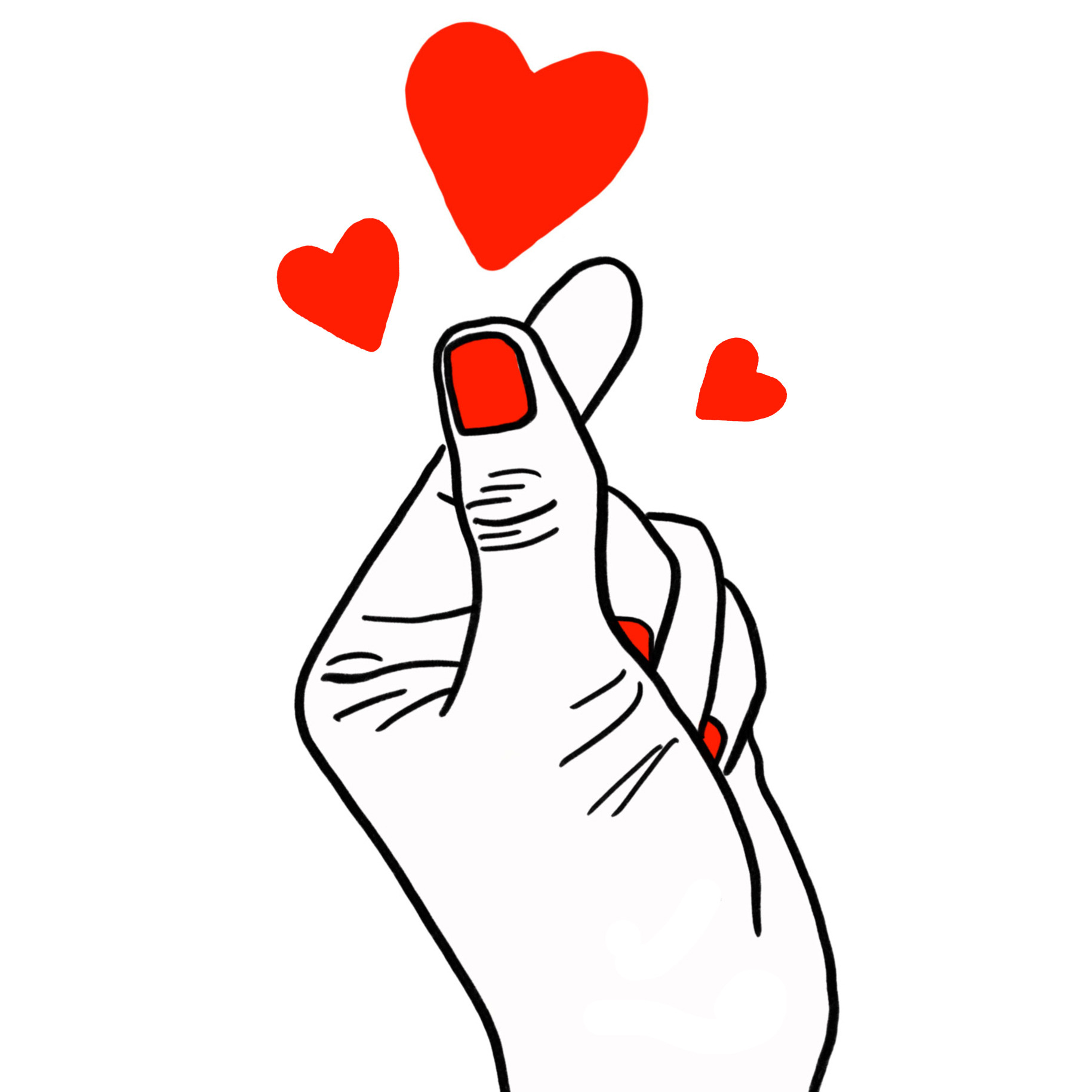




Chargement des commentaires…