C’est une vidéo qui relance le débat. Publiée le 17 octobre dernier, quelques semaines avant l’anniversaire du mouvement des gilets jaune, l’enquête vidéo du Monde sur la blessure du girondin Olivier Béziade soulève à nouveau la question des suites juridiques données aux plaintes pour violences policières.
Victime d’un tir de LBD dans la tête lors de l’acte 9 des Gilets jaunes à Bordeaux et alors qu’il ne représentait aucune menace : les images de ce pompier volontaire bazadais, allongé face contre terre, avaient été largement médiatisées au niveau national. L’intervention des forces de l’ordre avait alors été vivement critiquée.
Grâce à une modélisation 3D, à l’analyse de centaines d’images, les journalistes odalités de l’intervention, le non respect des procédure d’utilisation des armes et leur refus d’appeler les secours… Certains vont jusqu’à dire que cette enquête vidéo « fait le boulot de l’IGPN ».
Au moment des faits, suite à la plainte de ce tranquille père de famille de 47 ans, la procureure de la République de l’époque, Marie-Madeleine Alliot, avait en effet saisi l’IGPN (Inspection générale de la Police nationale) et une information judiciaire avait été ouverte au printemps. Sans nouvelles.
Mais si un an après le début des gilets jaunes, à l’échelle nationale, 10 000 gardes à vue et 3100 condamnations à l’encontre de manifestant ont été prononcées, sur 212 enquêtes confiées à l‘IGPN seules 18 ont donné lieu à une instruction judiciaire, 54 ont été classées sans suite et aucune mise en examen n’a eu lieu pour l’instant.
Des rapports alarmants sur les libertés publiques
Créé par le Syndicat des avocats de France, la LDH et de nombreux collectifs et associations bordelais, l’Observatoire girondin des libertés publiques (OGLP) a rédigé deux rapports, l’un publié en avril l’autre en octobre, sur le maintien de l’ordre à Bordeaux.
Au travers d’observations et de témoignages, ils évoquent « une politique d’intimidation » initiée par le préfet Didier Lallement et poursuivie par Fabienne Buccio. Outre les nassages, sommations inaudibles et recours massif aux gaz lacrymogènes conduisant selon eux à une escalade de la violence, les observateurs relèvent aussi le recours illégitime aux amendes de classe IV, les confiscations de matériel de street-medics et de journalistes, ou encore, pour ces derniers, l’exigence abusive de la carte de presse.
L’OGLP relève encore les pressions sur deux élus de la France insoumise (matraquage du député Loïc Prudhomme et plainte contre le maire de Saint-Yzan-de-Médoc, Segundo Cimbron).
Et le rapport de conclure : « Au regard de ces faits, il appartient à tout citoyen et citoyenne de s’interroger sur une telle gestion sécuritaire d’un mouvement qui réclame pacifiquement une égalité sociale, une égalité fiscale et plus de démocratie directe. »

Ascenseur émotionnel et enquêtes au ralenti
Ce sentiment de blocage, Benjamin le connaît bien. Simple passant, ce jeune Bordelais de 23 ans allait alors rejoindre des amis lorsqu’en traversant la place Jean-Moulin, à proximité de Pey-Berland, il a reçu un tir de LBD 40 en plein visage, toujours lors de cet acte 9. Il a perdu l’usage d’un œil et déposé plainte dans les jours suivants.
« Lors de la convocation à l’IGPN, une semaine après mon dépôt de plainte, j’ai été été très bien reçu. J’ai vraiment senti que le brigadier chef en charge de l’enquête s’est senti investi dans mon dossier. Par la suite tout les témoins ont été auditionnés. »
Au mois de mai, l’inspecteur le contacte pour l’informer que le tireur, un policier de la BRI, est identifié et qu’il transmet le dossier au parquet. Mais à la grande surprise de Benjamin sa plainte est classée sans suite le jour ouvré suivant son transfert.
« C’est l’ascenseur émotionnel. Je sais pertinemment qu’ils n’ont pas ouvert le dossier. Heureusement notre avocate nous a rassuré en nous disant que c’était habituel. »
Une justice de synthèse
Le jour de sa blessure, plusieurs journalistes, dont Fab Enero du collectif Macadam Press assistent pourtant à la scène et lancent un appel à témoin. Le recueil de documents et de vidéos alimentera un dossier d’enquête de près de 250 pages.
« On pense qu’une des causes probable est le rapport de synthèse. 8 pages pour résumer le dossier, c’est forcément un peu “orienté” comparé à la totalité de l’enquête » déclarent Benjamin et sa compagne.
Le policier à l’origine du tir ayant été identifié, le jeune homme réfléchit au dépôt d’une nouvelle plainte et à la poursuite de la procédure devant le tribunal pénal. D’autres préfèrent en référer au tribunal administratif suite au classement de leurs dossiers, aux révélations lors d’enquêtes ou à leur lecture politique des faits.

La tradition du maintien de l’ordre
Ce fut le choix rapidement assumé par Antoine Boudinet. Ce jeune Bordelais a perdu une main dans l’explosion d’une grenade, le 8 décembre 2018 à Bordeaux. Depuis il milite pour l’interdiction des armes dites sublétales au sein du collectif « Les mutilés pour l’exemple ».
« Avant d’être blessé je faisais partie des gens qui savaient sans savoir, qui savaient qu’il y avait des violences dans les quartiers, dans les ZAD, en manif mais qui se disaient que ça ne les concernait pas, explique Antoine. Puis vient la blessure, la réalité en plein milieu de la gueule et la prise de conscience qu’on n’est pas un cas unique mais juste la conséquence d’une longue tradition du maintien de l’ordre. »
Le Code de la sécurité intérieure prévoit pourtant la proportionnalité et la graduation de l’usage de la force. Mais à de nombreuse reprises durant les derniers mois, ces principes n’ont pas été respectés.
Pis : en vue de la validation prochaine du «schéma national du maintien de l’ordre», un document de travail du ministère de l’Intérieur que le journal Libération a pu consulter confirme la « nécessité d’aller au contact des manifestants », l’usage des armes dites intermédiaires et des brigades de répression à moto.
Aussi, Antoine, s’il reconnait la responsabilité individuelle de chaque agent à obéir ou pas aux ordres, souhaite mettre la chaine de commandement entière face à ses obligations.
« Même si ça doit durer 15 ans je ne lâcherai rien, j’irai les poursuivre jusqu’au bout. »
Il a donc déposé une plainte au tribunal administratif
Un blessé sur deux porte plainte
Mais sur la quarantaine de cas recensés par le journaliste David Dufresne, tous n’ont pas la même détermination. La crainte d’aller déposer plainte « contre la police dans les locaux de la police », le sentiment de ne pas être légitime comparé à des blessés « plus graves » ou encore la défiance face à la machinerie judiciaire l’emportent parfois.

Au CLAP 33, collectif qui accompagne les victimes d’abus policiers depuis près de 10 ans, on regrette ainsi qu’une vingtaine de plaintes seulement aient été déposées à Bordeaux.
« On n’a pas d’autre choix, souffle Myriam, représentante du CLAP 33. On peut manger alternatif, s’informer alternatif mais il n’y a pas de justice alternative. Or une personne qui reste sans justice, qui rentre chez elle, seule, avec ses questions, c’est une personne qui va avoir énormément de mal à se reconstruire. »
Mutilés aquitains : les armes mises en causes
- FREDERIC R., 35 ans, main arrachée le 1er décembre 2018 à Bordeaux.
Arme mise en cause : grenade GLI F4 - GUY B., ~60 ans, mâchoire fracturée le 1er décembre 2018 à Bordeaux.
Arme mise en cause : LBD 40 - MEHDI F., age inconnu, blessé au torse avec contusion pulmonaire le 1er décembre 2018 à Bordeaux.
Arme mise en cause : LBD 40 - ANTOINE B., 26 ans, main arrachée le 8 décembre 2018 à Bordeaux.
Arme mise en cause : grenade GLI F4 - JEAN-MARC M., 41 ans, a perdu son œil droit le 8 décembre 2018 à Bordeaux.
Arme mise en cause : LBD 40 - CLEMENT F., 17 ans, blessé à la joue le 8 décembre 2018 à Bordeaux.
Arme mise en cause : LBD 40 - MARIEN, 27 ans, double fracture de la main droite le 8 décembre 2018 à Bordeaux.
Arme mise en cause : LBD 40 - DAVID D., 31 ans, traumatisme facial avec fracture du nez le 8 décembre 2018 à Bordeaux.
Arme mise en cause : grenade de désencerclement - FABIEN R., 30 ans, fracture du testicule gauche nécessitant son ablation, le 15 décembre 2018 à Bordeaux.
Arme mise en cause : LBD 40 - LEA, age inconnu, fracture ouverte du pied, le 15 décembre 2018 à Bordeaux.
Arme mise en cause : LBD 40 - LOLA V., 18 ans, triple fracture de la mâchoire et plaie transfixiante de la joue le 18 décembre 2018 à Biarritz.
Arme mise en cause : LBD 40 - DAVID S. âge inconnu, nez cassé et 9 points de suture le 5 janvier 2019 à Bordeaux.
Arme mise en cause : LBD 40 - OLIVIER, 51 ans, traumatisme crânien avec hémorragie cérébrale, le 12 janvier 2019 à Bordeaux.
Arme mise en cause : LBD 40 + grenade de désencerclement - BENJAMIN, 23 ans, a perdu un œil et 6 fractures des os de la face et du nez le 12 janvier 2019 à Bordeaux.
Arme mise en cause : LBD 40 - MATHIEU, ~30 ans, une côte fracturée, le 12 janvier à Bordeaux.
Arme mise en cause : LBD 40 - FLORIANE, âge inconnu, nécrose du mollet ayant nécessité une greffe de peau, le 12 janvier à Bordeaux.
Arme mise en cause : LBD 40 - STÉPHANE, 44 ans, double fracture du bras et plaies au membres supérieurs, crâne et ventre, le 22 juin 2019 à Bordeaux.
Arme mise en cause : Matraque
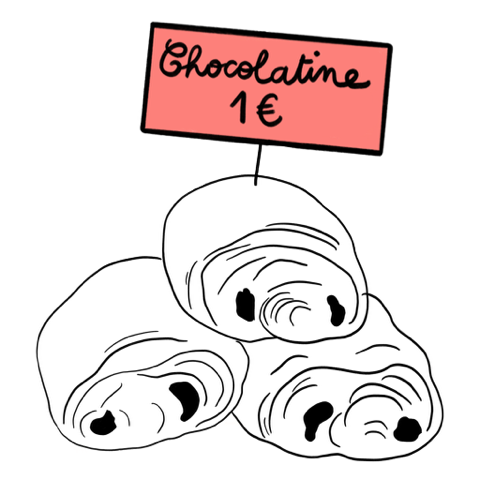
Cet article fait partie de l’édition abonnés. Pour lire la suite, profitez d’une offre découverte à 1€.
Contribuez à consolider un média indépendant à Bordeaux, en capacité d’enquêter sur les enjeux locaux.
- Paiement sécurisé
- Sans engagement
Déjà abonné⋅e ?
Connectez-vous
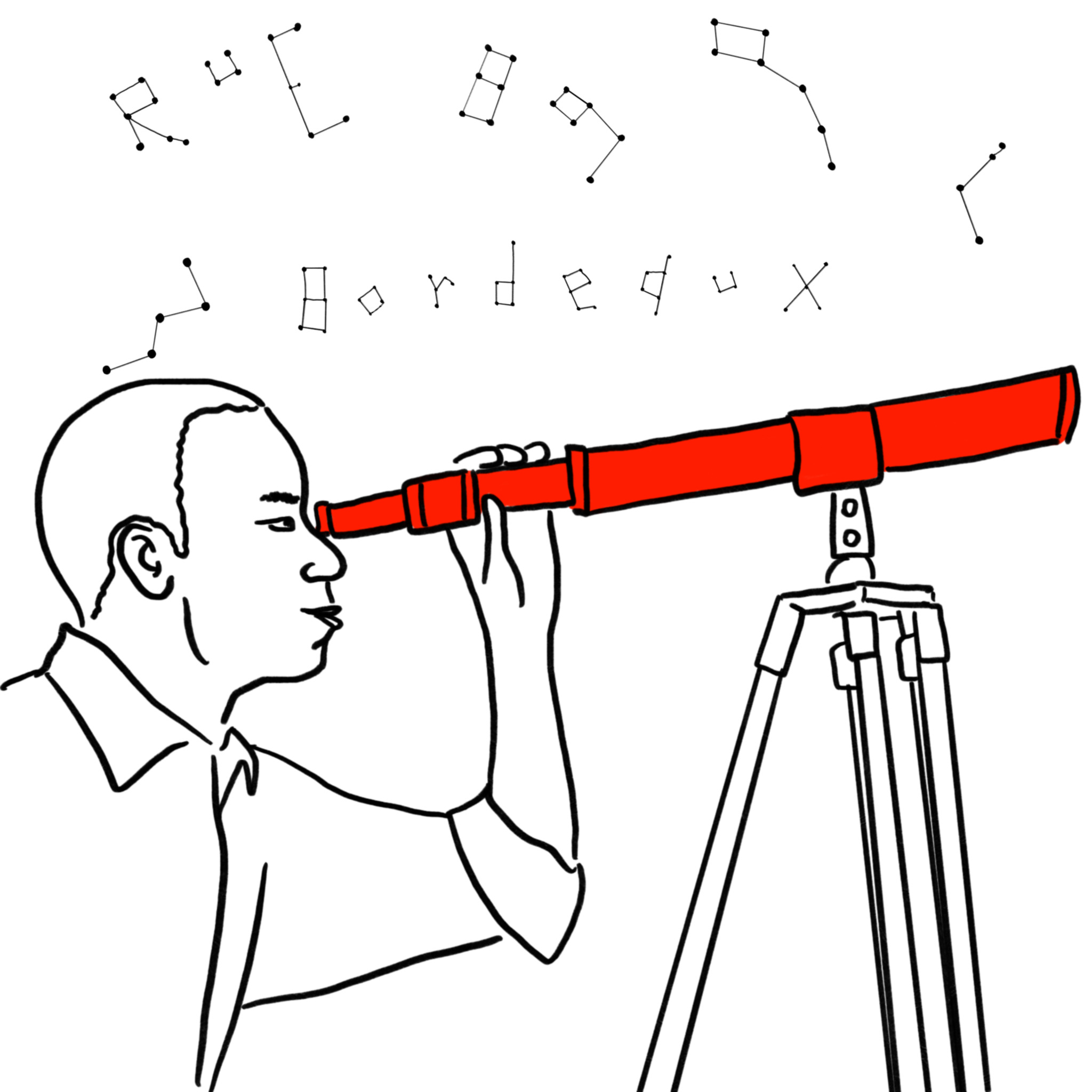
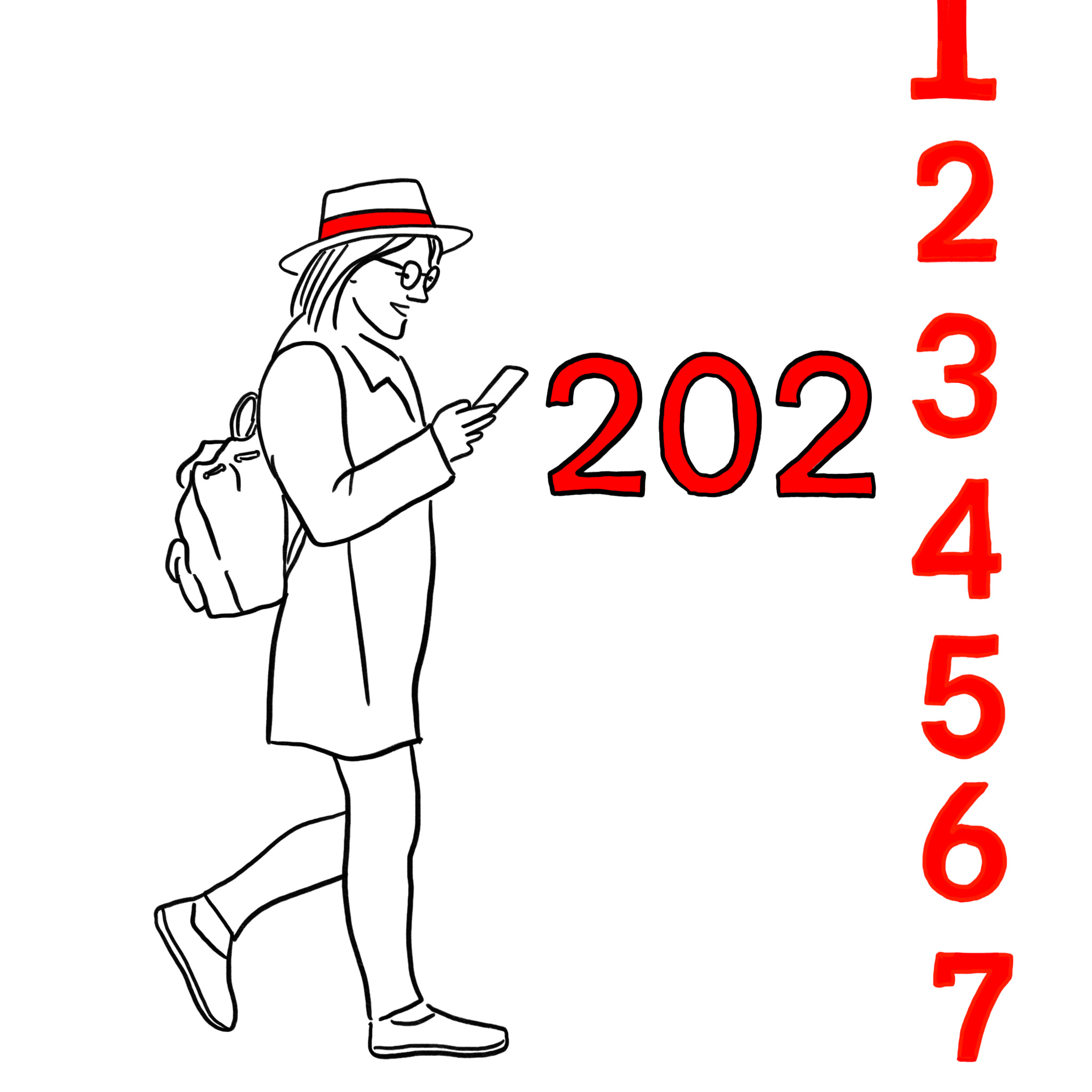
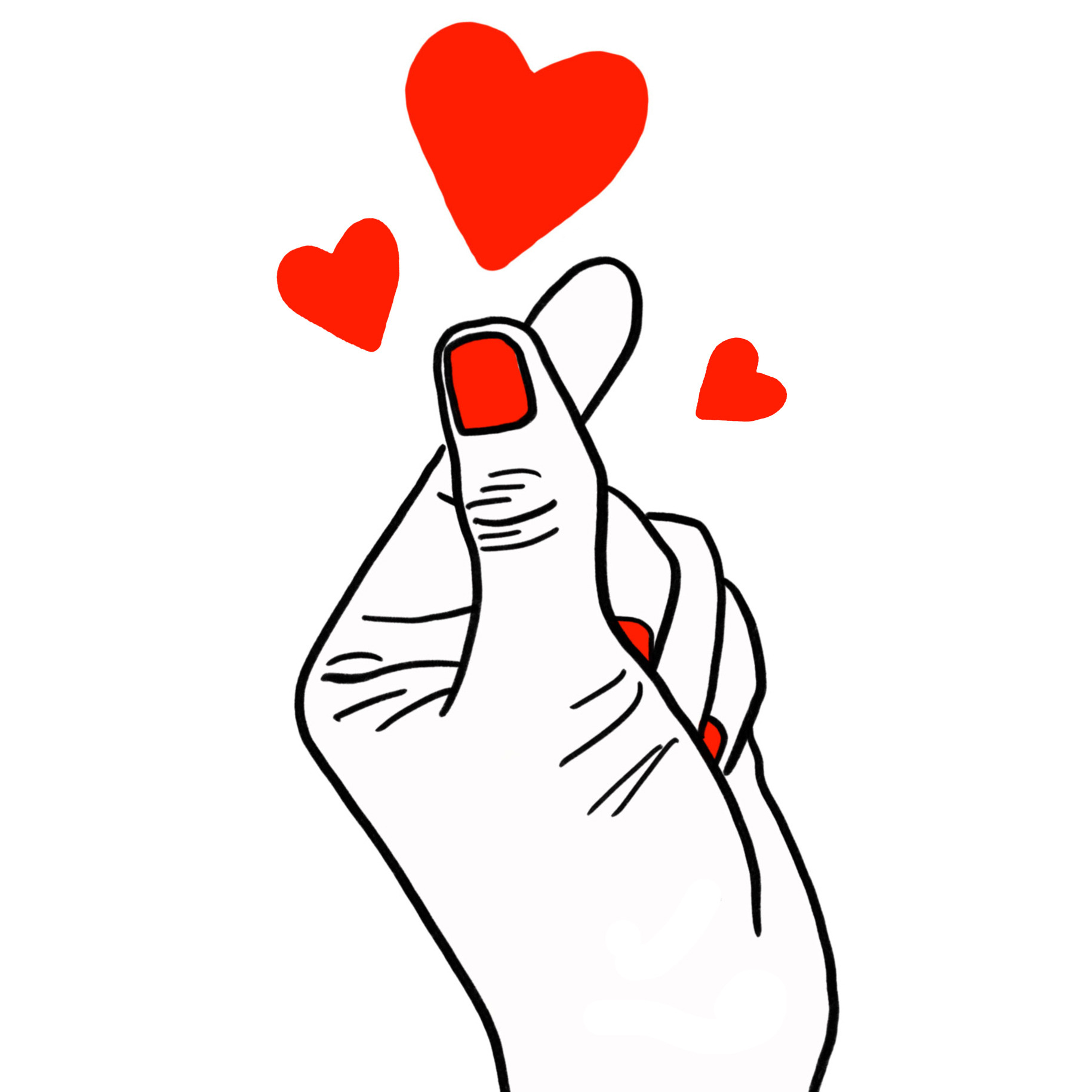




Chargement des commentaires…