Dossier #29 : Bordeaux mélange des genres
Jessica et Léo, deux Bordelais en transition
Agressions et discriminations LGBTphobes : que fait la police ?
Il ou elle ? Ce que Bordeaux fait pour conjuguer les genres
A Bordeaux, les avis divergent sur la prise en charge des personnes trans par la Sofect
En novembre 2016, une loi est venue nourrir l’espoir de la communauté trans : la loi n° 2016-1547 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit, entre autres, que « toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom » et que « toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification ».
« C’est le bonheur » pour Jessica, une autre femme trans, qui reconnaît depuis l’obtention de son nouvel état civil avoir « une vie normale ».
Si la loi offre de nouvelles garanties pour les personnes trans, le parcours pour y parvenir reste plein d’embûches. La première est le regard de la société qui entoure la personne en quête ou en cours de transition. À commencer par la terrible période de l’adolescence. Et Bordeaux n’est pas épargné.
« Une souffrance phénoménale »
« L’homophobie et la LGBTphobie sont des fléaux importants dans nos établissements, reconnaît Sandra Barrère, chargée de mission égalité filles-garçons au rectorat de l’Académie de Bordeaux depuis 2014. C’est pourquoi l’éducation nationale a lancé plusieurs campagnes sur les discriminations. En 2019, on a évoqué davantage l’homophobie. »
Le ministère chargé de l’éducation nationale a lancé en 2019 une nouvelle campagne nationale destinée à informer et sensibiliser les collégiens, les lycéens et l’ensemble des membres de la communauté éducative aux violences et discriminations à caractère homophobe et transphobe, reconnaissant que « trop de jeunes en souffrent ».
Sous le slogan « Ça suffit », cette campagne s’est fondée sur des chiffres qui ne laissent pas insensibles. Selon une étude de l’IFOP réalisée en 2018 pour la Fondation Jean-Jaurès et la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH), « l’établissement scolaire apparait comme le lieu au sein duquel les agressions LGBTphobes sont les plus courantes (devant la rue et les transports en commun) : 26 % des personnes LGBT déclarent y avoir fait l’objet d’injures ou de menaces verbales, 13 % d’une ou plusieurs agressions physiques ».
Pire encore, dans le vadémécum du ministère est citée une enquête récente sur la santé des mineurs LGBT scolarisés qui révèle, « en particulier chez les jeunes se définissant comme trans, un fort niveau d’appréhension face à l’École (qu’il s’agisse des pairs ou de l’institution) : l’expérience scolaire est perçue comme “mauvaise” ou “très mauvaise” par 72 % d’entre eux ».
« Dans les collèges et les lycées, l’identité est arbitrée par le groupe. Si elle mal arbitrée, c’est terrible pour la personne, c’est une souffrance phénoménale » précise Sandra Barrère.
Caprice ?
Bien qu’aucune statistique à l’échelle de l’Académie de Bordeaux ne puisse être fournie, « nous pouvons imaginer les mêmes chiffres qu’à l’échelon national » selon Sandra Barrère. La chargée de mission souligne cependant que dans la circulaire du ministère, « le terme LGBT apparaît enfin ».
« On a été précurseur à l’échelle de l’Académie. Nous avons été les premiers à enclencher des formations pour les personnels en charge des harcèlements. J’ose espérer que les choses se passent bien et dans de bonnes conditions. Il faut imaginer qu’il y a aussi des angles morts. »
L’Académie réunit régulièrement les référents de ses cinq départements pour des mises à jour des formations répercutées ensuite sur les personnels. Elle a par ailleurs discerné, avec la préfecture de Nouvelle-Aquitaine et la Direction régionale aux droits des femmes, le prix du « Projet égalitaire », pour sa première édition annuelle, au Lycée Pape-Clément à Pessac pour son travail éducatif autour des discriminations.
Qu’en est-il du changement de nom ou d’identité pour une personne trans élève des établissements ?
« Il est important que la demande soit formulée par les parents, précise Sandra Barrère. Mais on ne peut pas forcer les personnels de l’établissement de l’élève à la respecter s’ils prétendent que ça relève du caprice. »
Dans certains cas, les établissements font appel à des associations. Contact Aquitaine répond à ce genre de demande.
‘Tout ce qui touche à la sexualité est assimilé à la pornographie »
L’association Contact est une association nationale avec 25 antennes en France. Depuis une vingtaine d’années, celle de Bordeaux couvre, en plus de l’ex Aquitaine, la Charente et la Charente-Maritime. Elle organise des groupes de paroles entre parents concernés « pour partager leurs vécus ».
« On va également dans des collèges et des lycées pour rencontrer les élèves et parler d’homophobie, de transphobie et de harcèlement scolaire, précise Peio, le responsable de l’antenne bordelaise. On rencontre 2000 élèves environ par an. »
Vincent Buraud, psychopraticien bordelais et prestataire de services pour l’association Contact en France, anime des interventions en milieu scolaire sur les discriminations à caractère sexiste et LGBT+phobie. Il intervient dans les collèges et les lycées, dans les classes de 4e, 3e, seconde et première, à la demande du Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) de chaque établissement scolaire du second degré qui organise ce type de partenariat en fonction des problématiques éducatives à traiter.
« Ça se passe différemment à chaque fois, selon l’énergie du groupe et selon la manière dont les élèves fonctionnent déjà entre eux, explique Vincent Buraud. Il y a parfois des cas extrêmes où des élèves, des garçons en général, prennent en otage le groupe avec une pensée unique et radicale. Ce sont des élèves qui ne reconnaissent pas les propos de l’adulte, des élèves déjà abimés sur les liens entre l’adulte et l’enfant. Ils sont en rupture de confiance. Le groupe se retrouve ainsi complètement paralysé. Parfois, j’en arrive à arrêter l’intervention. »
Le psychopraticien est souvent accompagné par des parents concernés à qui les élèves s’adressent en fin de rencontre.
« L’intervention des élèves touche à l’intime. Pour beaucoup, tout ce qui touche à la sexualité est assimilé à la pornographie. Ils vont réagir avec des mécanismes de défense et, souvent, le rire en est un. Pour ça, il y a un cadre posé au départ, établi avec les élèves, qui doit permettre une mise en sécurité. Mais, en 12 ans d’intervention, il y a une accélération dans les mentalités depuis deux/trois ans, après le “Mariage pour tous”. Les questions des enfants sont sur la parentalité : comment vous allez faire pour avoir des enfants, ou de petits-enfants ? Avant, parler de parentalité c’était monstrueux. Ce n’était absolument pas concevable qu’un couple d’hommes ou de femmes ou des trans élèvent des enfants. »

Le ministère s’en mêle
A l’Université de Bordeaux, Marion Paoletti ne chôme pas sur ces questions. La chargée de mission Égalité femmes-hommes, en place depuis 2014, a vu sa tâche s’élargir en 2015 à l’ensemble des discriminations. C’est devenu la mission Parité, égalité, diversité.
« J’ai mis en place une cellule de veille contre le harcèlement sexuel, violences sexistes et homophobes et je fais un bilan tous les ans. Je n’ai jamais été saisie sur un cas d’homophobie », assure Marion Paoletti.
En février 2019, l’Université de Bordeaux publie les résultats d’une enquête « Sentiment et expérience des discriminations de la communauté de l’Université de Bordeaux ». Menée auprès des étudiants et du personnel, elle a obtenu 6 538 réponses (respectivement 4776 et 1762).
Auprès des étudiantes et des étudiants, l’orientation sexuelle comme cause de discrimination est mentionnée par 136 réponses (9,4%). Ce qui la classe en 8e position, loin derrière les discriminations racistes. Dans les conclusions, « ce résultat peut suggérer une stigmatisation à l’égard des personnes homosexuelles ».
En revanche, l’identité de genre (9e position) « est également un facteur de discrimination récurrent ». Des témoignages « déplorent notamment le manque de sensibilisation à l’égard des luttes LGBTQI et du manque d’accompagnement des services administratifs dans les démarches de changement de nom ».
La ministre de l’enseignement supérieur, Frédérique Vidal, avait en mars 2019 adressé un courrier aux chefs d’établissements, également signé par la Conférence des présidents d’université (CPU), les invitant à faciliter les changements de prénoms des personnes trans. La reconnaissance du prénom d’usage est en place depuis la rentrée 2019 dans les logiciels Apogée et SVE/Scolarix qui gèrent les inscriptions selon le site du ministère. Une initiative qui simplifie beaucoup de choses pour Marion Paoletti.
Un gap générationel
« Entre 2014 et la rentrée de cette année 2019, on a accompagné individuellement quatre demandes de changement de prénom. […] Ce n’était pas satisfaisant puisque ça se passait au cas par cas et ça demandait une énorme coordination et une organisation des services très importante : informatique, bibliothèque, scolarité… La circulaire ministérielle facilite l’utilisation du prénom d’usage pour les documents internes à l’établissement ; là où on a la main. On a constitué un groupe de travail avec tous les services représentés et lister l’ensemble de la procédure, ce plan a été présenté le 5 décembre à notre conseil de formation de la vie universitaire qui l’a adopté. Ce qu’on va donc pouvoir faire tant que l’étudiant ou l’étudiante n’a pas modifié son état civil, c’est changer le prénom sur la carte étudiante, la carte du bibliothèques, les listes électorales, l’émargement des candidats du matériel électoral, l’affichage des résultats des examens, et sur tous les contrats d’accompagnement des étudiants en situation de handicap. Mais on ne pourra pas agir s’il n’y a pas eu de changement d’état civil, sur les documents ministériels comme les diplômes, les contrats doctoraux… »
Le personnel en lien avec ces démarches sera accompagné avec par exemple l’édition d’un glossaire LGBTQI+ pour s’adapter à « ce chantier énorme ».
L’association Wake up, créée en 2000 pour accompagner les étudiants de la métropole bordelaises à l’université, intervient de son côté auprès du personnel « qui manque d’informations sur l’accueil des personnes LGBT ».
« Comment faire pour ne pas vexer une personne transidentitaire par exemple ? explique Maxime Thibaud, président de l’association depuis 2018. Les gens sont demandeurs. Ils demandent qu’on leur explique. Parfois ils perçoivent mal que des personnes changent de sexe. »
Suite au rapport de février 2019, une formation pour les cadres de l’Université a été donnée par le cabinet Egaé, co-fondé par la militante féministe Caroline de Haas, « portant sur le management inclusif » précise Marion Paoletti.
« C’est évident qu’il y a un gap générationnel pour le personnel. Le changement est tellement important ! Chez les jeunes, c’est fluide désormais. Ça se fait tout seul. La tolérance devient une évidence. C’est à souligner mais je ne minimise pas les insultes, il y en a. Avec 60000 étudiants, il y en aura toujours. »
Ce que confirme Maxime Thibaud : « Pas de comportements hostiles flagrants ou récurrents, ça se passe plutôt bien. »
« Bordeaux est une ville tolérante. L’homophobie, la lesbophobie, la biphobie, ça se manifeste généralement en soirée, mais ça reste rare. Il y a toujours des gens qui ne sont pas d’accord. C’est à l’extérieur de Bordeaux que c’est plus difficile. A la campagne, le sujet est plus tabou, il y a plus d’incompréhensions. »
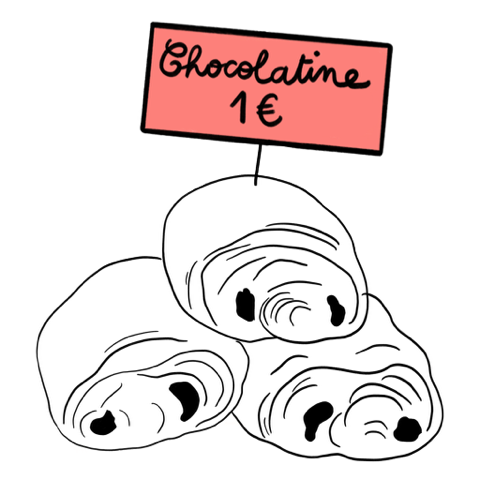
Cet article fait partie de l’édition abonnés. Pour lire la suite, profitez d’une offre découverte à 1€.
Contribuez à consolider un média indépendant à Bordeaux, en capacité d’enquêter sur les enjeux locaux.
- Paiement sécurisé
- Sans engagement
Déjà abonné⋅e ?
Connectez-vous
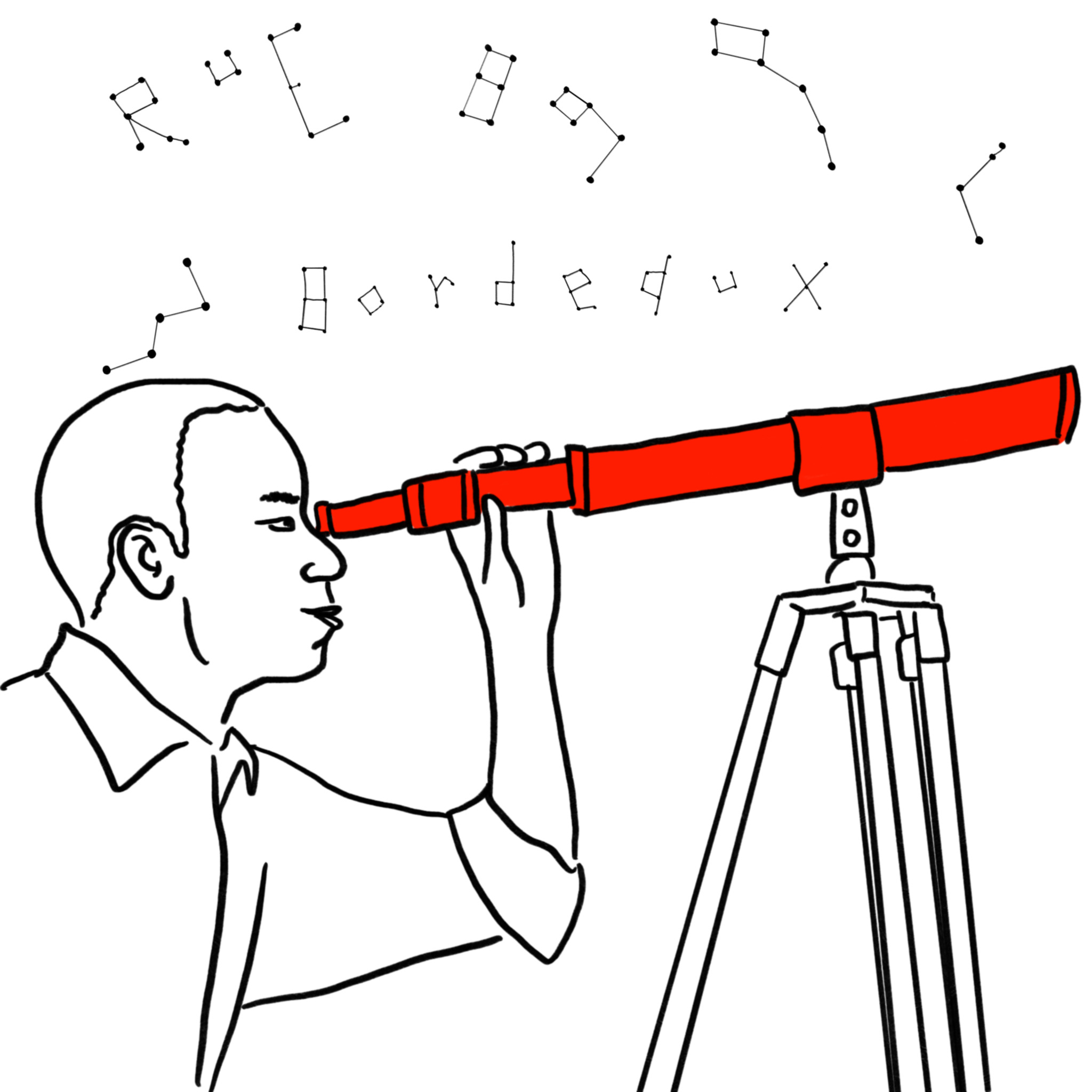
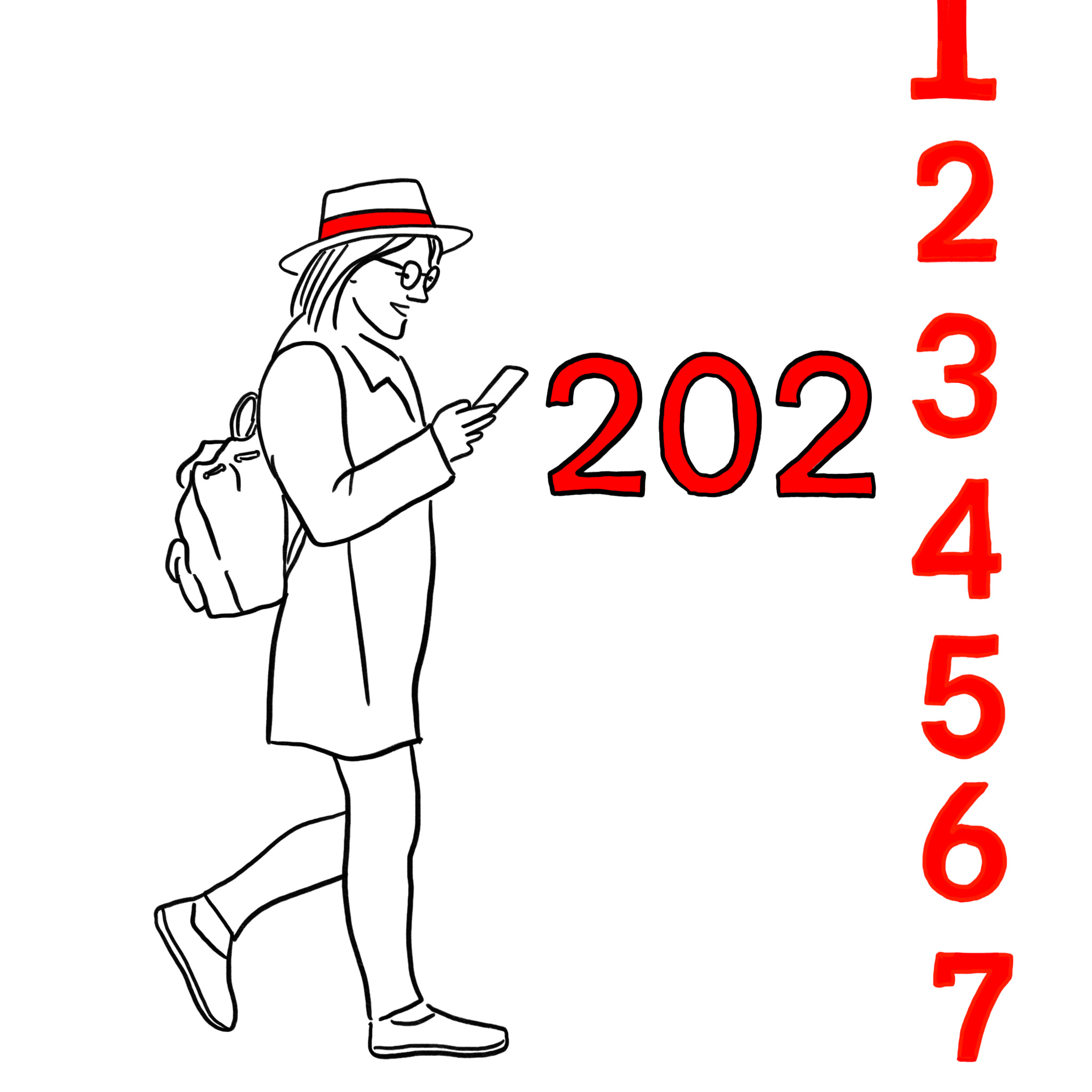
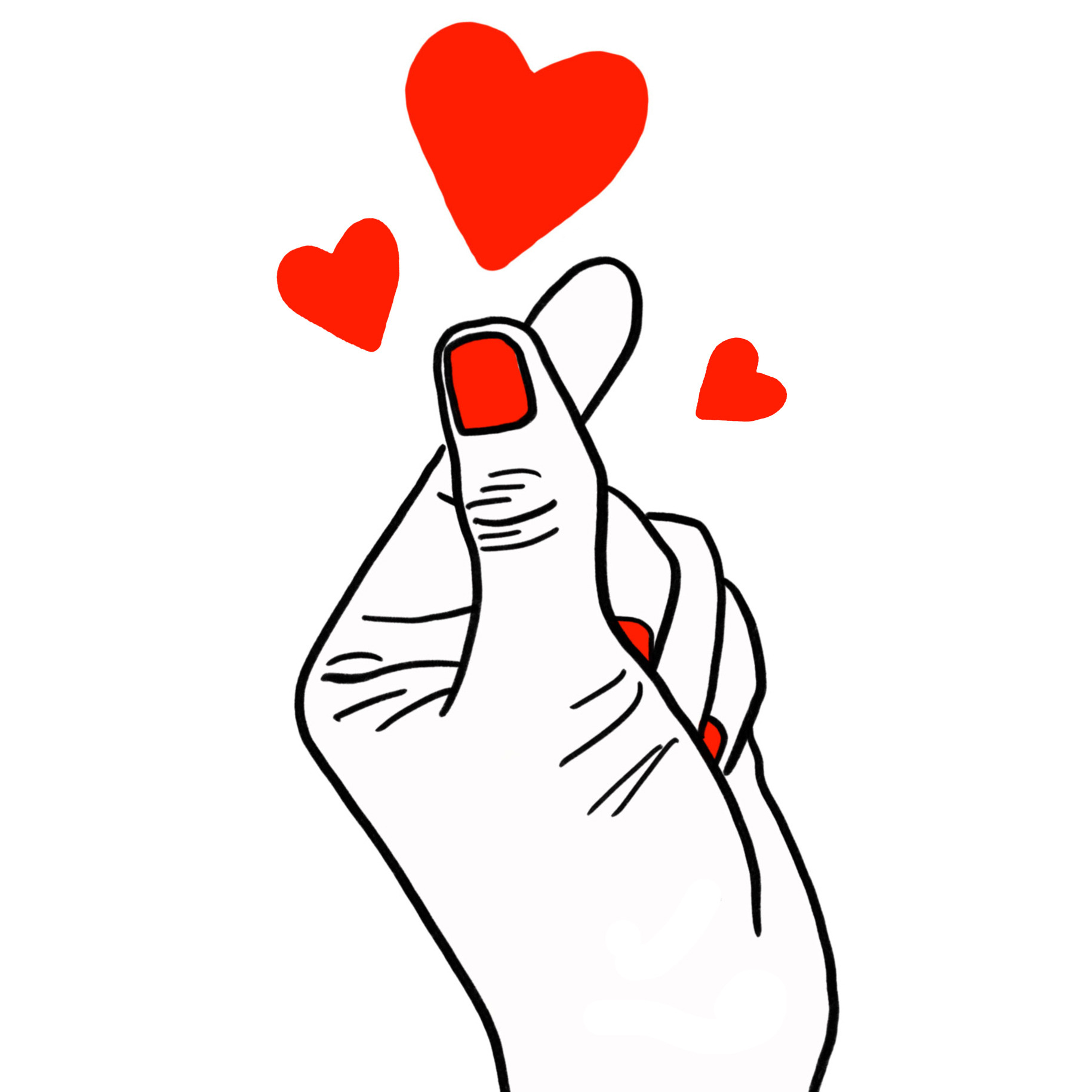




Chargement des commentaires…